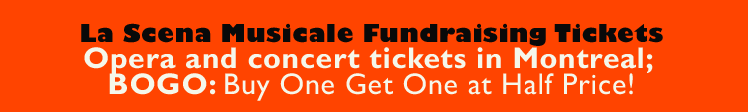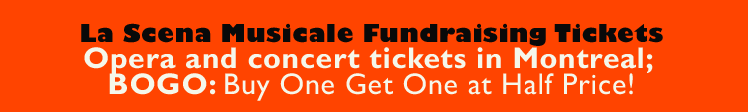Prokofiev, la dernière victime de Staline Par Norman Lebrecht
/ 4 juin 2003
English Version...
Initiation à la musique
 L'histoire ne compte aucune
autre heure pareille. Le soir du 5 mars 1953, entre 21 h et 22 h, dans une
datcha en bordure de Moscou, Joseph Staline s'éteignait d'une hémorragie
cérébrale. Cinquante minutes plus tôt, dans un appartement communal de Moscou,
Serge Prokofiev venait de succomber à un accident vasculaire cérébral. Une telle
coïncidence est sans pareille – il aurait fallu, par exemple, que Shakespeare
s'éteigne dans l'heure suivant le décès d'Élisabeth Ire ou que Goethe rende
l'âme le même soir que Napoléon. Potentat et artiste, tyran et victime, ils
furent unis de façon singulière par la mort et sont demeurés inséparables
depuis. L'histoire ne compte aucune
autre heure pareille. Le soir du 5 mars 1953, entre 21 h et 22 h, dans une
datcha en bordure de Moscou, Joseph Staline s'éteignait d'une hémorragie
cérébrale. Cinquante minutes plus tôt, dans un appartement communal de Moscou,
Serge Prokofiev venait de succomber à un accident vasculaire cérébral. Une telle
coïncidence est sans pareille – il aurait fallu, par exemple, que Shakespeare
s'éteigne dans l'heure suivant le décès d'Élisabeth Ire ou que Goethe rende
l'âme le même soir que Napoléon. Potentat et artiste, tyran et victime, ils
furent unis de façon singulière par la mort et sont demeurés inséparables
depuis.
Aux obsèques de Prokofiev, on ne
vit pas de fleurs, les hommes de Staline ayant fait main basse sur le moindre
bourgeon. Le cortège compta à peine une quarantaine de personnes, toute
l'attention étant tournée vers la perte de la nation.
Il fallut trois jours avant que l'Ouest apprenne la mort de Prokofiev, trois
autres avant qu'elle soit annoncée dans la Pravda. Néanmoins, la nouvelle se répandit.
Les musiciens du quatuor à cordes qui jouaient près de la dépouille de Staline
pleurèrent à chaudes larmes – en pensant à Prokofiev.
Moins de trois ans plus tard,
les crimes de Staline étaient dénoncés par Nikita Khrouchtchev au XXe Congrès du
Parti et le « Petit Père des peuples » était relégué aux oubliettes. On observa
un certain dégel. Alexandre Soljenitsyne écrivit sur le Goulag ; Dmitri
Chostakovitch codifia la Grande Terreur dans ses symphonies. Les artistes qui
avaient survécu à Staline effacèrent sa marque de leurs œuvres. Prokofiev, qui
mourut avec lui, demeure à demi condamné par association.
Il est pourtant l'un des compositeurs les plus connus de l'époque moderne.
Pierre et le loup est joué dans les garderies et non seulement son
Roméo et Juliette est-il dansé par des troupes de
ballet, il retentit aussi comme un hymne guerrier dans les stades de
football.
Toutefois, à l'exception de ces
deux succès, l'ensemble de sa production, quelque 135 œuvres, est peu reconnue.
Sa musique est assombrie par cette sorte de malaise que nous pourrions ressentir
dans une chambre de torture médiévale, un mélange de curiosité hésitante et
d'appréhension larvée.
Des sept grandes symphonies de
Prokofiev, seules la première et la cinquième sont jouées assez régulièrement ;
de ses cinq concertos pour piano, seuls le troisième et le cinquième. Combien
sommes-nous à pouvoir nommer au moins 3 de ses 10 opéras ? À les avoir vus ?...
Combien de pianistes vivants jouent les neuf sonates comme le cycle de leur vie
?
Il n'existe au sujet de
Prokofiev aucun débat comme ceux qui entourent Chostakovitch, voire Tchaïkovski;
sa musique ne contient aucun message chiffré, seulement de la mélodie féconde et
une originalité pétillante. Personne ne remet non plus en question sa stature.
Prokofiev est universellement reconnu comme l'un des plus grands compositeurs du
XXe siècle, bien qu'il soit parmi les plus négligés. Ce paradoxe s'explique par
ses rapports complexes avec le stalinisme.
Ayant quitté la Russie après la
révolution, Prokofiev y est retourné en 1933 et s'y est fixé en 1936. Il fut le
seul génie assez naïf pour croire aux promesses d'asile de Staline. Sa création
fut d'abord stimulée par la vie théâtrale de Moscou et l'amitié d'interprètes
sensibles, comme David Oistrakh, pour lequel il a écrit deux concertos, et les
pianistes Sviatoslav Richter et Emil Gilels. Il jouissait d'un statut social
privilégié, d'un appartement confortable et d'une maison à la
campagne.
Voyant cependant des amis disparaître lors de la première purge stalinienne,
Prokofiev eut la lâcheté d'écrire une cantate pour le XXe anniversaire de la
révolution, une ode à Staline à l'occasion de son soixantième anniversaire,
Zdravitsa, et divers hymnes à la gloire de barrages
hydroélectriques. À l'étranger, il fut qualifié de propagandiste officiel. Le
magazine Time titrait ainsi une couverture en 1945 : « Il marque le temps au
métronome marxiste ».
Les étrangers ignoraient que sa
première femme, Lina, et leurs deux fils étaient détenus en otages en Sibérie
afin d'assurer sa soumission.
Lors de la deuxième purge
ordonnée par Staline, il fut publiquement condamné, privé de travail et réduit à
l'indigence, alors qu'il composait les dernières sonates dépeignant, selon les
mots de Richter, « un monde qui a perdu ses assises ».
Son garde-manger fut regarni
grâce à l'intervention du jeune violoncelliste Mstislav Rostropovitch, qui força
la porte du premier bourreau de Prokofiev, le secrétaire général de l'Union des
compositeurs, Tikhon Khrennikov, et le prévint qu'il serait tenu personnellement
responsable si Prokofiev devait mourir dans sa misère. Khrennikov dénicha 5000
roubles.
À la mort de Staline, Chostakovitch put faire oublier ses hommages forcés
dans sa Dixième Symphonie, d'un laconisme cinglant. Même dans
sa tombe, Prokofiev ne pouvait se blanchir de ses compromissions. Aux yeux de
l'histoire, il fait figure d'homme vénal, soucieux de son confort et sans
courage. La grimace de Staline continue d'entacher sa réputation.
Les efforts déployés à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa mort
pour réhabiliter ses
œuvres de propagande sont regrettables. Ses cris de
Zdravitsa (Bonne santé!) lancés à Staline au South Bank
de Londres et à Carnegie Hall ne peuvent que durcir les idées préconçues et
fournir un prétexte pour retarder l'heure de notre réconciliation avec
Prokofiev.
Les attitudes occidentales
envers ce compositeur sont assez troublantes. Au lieu de soumettre Prokofiev à
une évaluation critique continue, nous répétons les mêmes œuvres aimées du
public et nous ignorons le reste. Prokofiev crée un malaise que n'inspire pas
Ravel, par exemple. Il nous rappelle des choses que nous aimerions plutôt
oublier – d'abord et avant tout notre complaisance envers Staline. La nôtre,
oui, mais pas la sienne.
J'ai sous les yeux le programme
d'un concert donné le dimanche 21 décembre 1941 par le BBC Symphony Orchestra et
Sir Adrian Boult, « en l'honneur du 60e anniversaire de Staline ». Le principal
compositeur inscrit au programme était Prokofiev. J'ai aussi d'autres documents
de cette époque où Walton, Bliss et Malcolm Sargent chantent allégrement les
louanges de Staline.
Toute la civilisation
occidentale était prosternée pour obtenir un sourire de l'oncle Joseph et, comme
le dit justement Martin Amis, l'Ouest n'a jamais reconnu qu'il avait
généreusement nourri la mégalomanie du monstre. Prokofiev, en mourant avec
Staline, est enseveli avec lui dans notre inconscient collectif. Nous évitons la
plus grande partie de sa musique en raison des associations qu'elle évoque et
les Russes la traitent avec circonspection parce que le mal est toujours
menaçant.
Avec un
demi-siècle de recul, il devrait être possible de séparer Prokofiev de son
époque, mais l'histoire est une réalité fluide, récrite au jour le jour. Tikhon
Khrennikov, qui aura 90 ans cet été, arpente toujours les rues de Moscou, niant
qu'il ait persécuté les compositeurs pour d'autres raisons que des délits
financiers. Prokofiev n'a jamais souffert de ses décisions, soutient-il. En
février 2003, Khrennikov a reçu de Vladimir Poutine le prix du Président, la
décoration la plus prestigieuse de l'État russe. Entre-temps, demeure ce silence
de Prokofiev.
[Traduction d'Alain Cavenne]
English Version... |