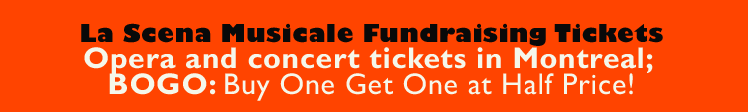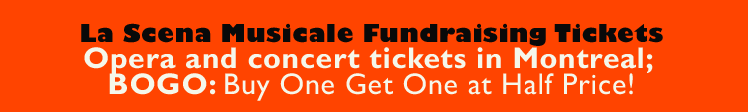Une nouvelle grammaire musicale: prémices et premiers essais Par Pierre Grondines
/ 1 novembre 2000
English Version...

Répondant vers 1944 à Pierre Boulez, alors jeune élève au Conservatoire de Paris, qui demandait anxieusement à son maître quel compositeur saurait donc enfin sortir la musique moderne de l’impasse où elle se trouvait, Messiaen aurait dit: "Vous, Pierre!."
S’il est impossible de prétendre qu’il ait pu n’y avoir qu’une seule issue à l’impasse perçue par un Boulez de 19 ans dans la musique de son temps – ou même qu’il y ait vraiment eu impasse! –, il faut au moins reconnaître à ce dernier qu’il aura puissamment contribué au cours de sa carrière au développement d’une pensée musicale rigoureuse et neuve, à savoir le sérialisme, qui aura marqué son temps. Un retour sur ce qui a conduit à l’éclosion de cette pensée musicale est indispensable pour en comprendre la raison d’être. Tel sera l’objet du présent article. On verra dans l’article suivant ("Premières lettres de noblesse du sérialisme"), qu’une œuvre comme Le Marteau sans maître, issue de la mouvance de la pensée sérielle, a su illustrer la viabilité artistique de cette voie.
Constat de faillite
Dans la décade qui a suivi l’après-guerre en Europe, une poignée de jeunes compositeurs désireux de faire table rase des esthétiques de l’entre-deux-guerres est en quête d’une nouvelle grammaire musicale. Parmi eux, le Français Pierre Boulez, les Belges Henri Pousseur et Karel Goeyvaerts ainsi que l’Allemand Karlheinz Stockhausen. Au cœur de leur motivation, un constat: l’œuvre des néoclassiques – c’est-à-dire le Stravinski d’après 1920 et les Milhaud, Poulenc, Auric et autres – serait caduque. La musique de ces derniers, admettant parfois le trivial, comportant à d’autres moment des allusions habiles aux manières des grands maîtres du passé, relèverait plus d’une esthétique d’illusionniste que d’une véritable profondeur de l’expression. Qu’on songe au Concert champêtre pour clavecin et orchestre (1928) de Poulenc, puisant à la tradition du baroque français ou à la Symphonie en ut (1939) de Stravinski se référant à Haydn et à Beethoven. On leur reproche aussi leur légèreté face à la question de la langue musicale: ils se seraient plus ou moins complu dans le vocabulaire de l’harmonie classique en l’ "encanaillant" de savoureuses fausses notes, pour faire moderne à peu de frais, estime-t-on. Un procès moral implicite sous-tend ces vues apparemment excessives. Il faut bien comprendre que pour un compositeur ayant 20 ans après 1945, pendant que l’Europe se relève de sa ruine matérielle, il est difficile de ne pas associer la musique trop aimable des néoclassiques de l’entre-deux-guerres à la faillite éthique d’une époque qui a permis la montée des totalitarismes et une seconde guerre mondiale.

Webern: le seuil
En fait, un seul compositeur de l’entre-deux-guerres trouve grâce aux yeux des intransigeants de la génération montante – il n’a rien d’un néoclassique, il est vrai. Il s’agit d’Anton Webern (1883-1945), l’un des représentants de la Seconde École de Vienne, aux côtés d’Alban Berg (1885-1935) et d’Arnold Schœnberg (1874-1951). Disciple de Schœnberg, Webern a été un adepte de la première heure du dodécaphonisme, inventé par son maître en 1923. Né du désir d’assurer à l’écriture atonale une plus grande cohésion, le dodécaphonisme de Schœnberg préconise l’emploi constant, dans une œuvre donnée, d’une seule et même "série" (ou de ses variantes), ensemble formé des 12 hauteurs de l’échelle chromatique, ordonnées selon une séquence choisie par le compositeur. L’apparition de toute note au cours de l’œuvre est commandée par la série. Preuve de ce qu’une technique n’est pas synonyme de style, les œuvres dodécaphoniques de Webern, toutes de concentration et d’ascétisme, se démarquent étonnamment de celles de Schœnberg. Au faîte de son évolution stylistique, Webern inaugure une façon visionnaire de concevoir l’espace musical qui, partie du contrepoint traditionnel, aboutit à une sorte de dispersion de la substance musicale en brefs motifs isolés, comme dans la Symphonie, op. 21 (1928). Dédaigneuse de l’effet facile, l’écriture hautement disciplinée de Webern atteint paradoxalement à une forme inattendue de séduction sonore que l’on pourrait rapprocher – dans son essence – de celle des pages les plus sévères d’un Bach. Cette exigence de la construction musicale de même que l’absence de tout retentissement de son œuvre du vivant du compositeur conféreront autour de 1950 un énorme prestige moral à Webern.
La musique des trois Viennois, longtemps méconnue en France, est diffusée auprès de jeunes compositeurs dans le Paris d’après la Libération grâce à l’enseignement de René Leibowitz, chef d’orchestre et ancien proche de Schœnberg. Fascinée, la nouvelle génération découvre, dans les conceptions musicales de Webern tout particulièrement, les bases même de la grammaire nouvelle qu’elle cherche alors si ardemment à créer.
Le sérialisme intégral
Partis de l’exemple de Webern, les
Boulez, Pousseur, Goeyvaerts et Stockhausen – influencés un moment par
Messiaen (son Mode de valeur et d’intensité pour piano, 1949) et stimulés
par leurs échanges au cours des séminaires estivals de nouvelle musique de
Darmstadt (Allemagne de l’Ouest) – conçoivent, dans un climat d’émulation
réciproque presque fébrile, une nouvelle grammaire musicale. On la nomme
diversement: "sérialisme", "sérialisme
intégral", "sérialisme postwebernien ", etc. Suivant cette nouvelle approche musicale, il devenait loisible d’étendre à toutes les caractéristiques d’un son (sa durée, sa dynamique, etc.) le type de traitement que le dodécaphonisme de Schœnberg ne réservait, 30 ans plus tôt, qu’aux seules hauteurs.
Désormais, une série de hauteurs ne suffisait donc plus. Avant de poser une seule note sur le papier à musique, il incombait au compositeur sérialiste de concevoir aussi d’autres types de séries, chacune chargée de contrôler un aspect particulier du son. En plus de la traditionnelle série déterminant l’ordre d’apparition de toute hauteur dans l’œuvre, une autre série concernait les durées de chacune de ces hauteurs (une blanche, une double croche, etc.), une autre encore, leurs dynamiques (forte, pianissimo, etc.), et ainsi de suite. En définitive, chaque note inscrite sur le papier à musique était l’aboutissement du croisement de ces séries.
Cette approche, dans laquelle le compositeur abandonnait le con-trôle ponctuel des événements sonores à des séries prédéfinies, a produit des œuvres comme Polyphonie X (1951), Structures I pour deux pianos (1952) de Boulez, la Sonate pour deux pianos (1951) de Goeyvaerts, ou encore Punkte (1952) de Stockhausen. Ces premières œuvres issues du sérialisme intégral sont farouchement athématiques et cultivent, à des degrés divers, le contour sonore en ´dents de scieª perpétuel, de même qu’un "pointillisme" – expression empruntée à la technique picturale bien connue d’un Georges Seurat, et consistant, musicalement, en une individualisation extrême de chaque son.

"Qu’ils nous donnent des œuvres!"
De leur propre aveu, les compositeurs avaient vite ressenti ce que le langage des premiers ouvrages sériels avait de contraignant et de quasi mécanique. Eux, naguère si intransigeants à l’endroit de leurs prédécesseurs, risquaient de se faire reprocher de transcrire sur des portées des structures numériques. "Qu’ils nous donnent des œuvres!" s’impatientera d’ailleurs un certain Auric dans les années 50. Les promoteurs du sérialisme intégral comprennent vite que si leurs premiers exercices étaient légitimes et nécessaires, il restait maintenant à démontrer la validité de la nouvelle grammaire sur le plan artistique par des œuvres absolument convaincantes.n
(À suivre dans le prochain numéro, "Le
Marteau sans maître: premières lettres de noblesse du
sérialisme ")
Pierre Grondines est chef de chœur et musicologue. Il enseigne au Conservatoire de musique de Québec et au Département de musique du Cégep de Sainte-Foy.
English Version... |
|