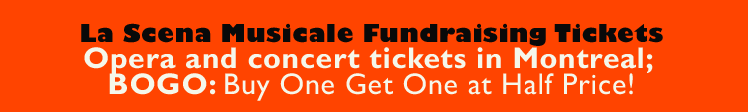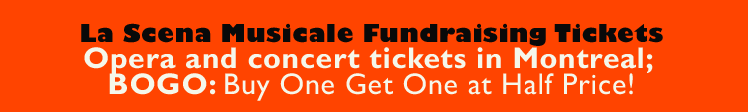Jazz : Autres perspectives, La Médiathèque Jazz du FIJM, Au rayon du disque Par Marc Chénard
/ 1 novembre 2011
English Version...
Version Flash ici.
Autres perspectives
Quand la musique
fait l’objet d’une couverture dans les médias, la nouvelle s’adresse
plus souvent qu’autrement à un public de convertis. Dans une large
mesure, les journalistes spécialisés dans un genre estiment que le
lectorat fait partie de la même chapelle qu’eux, en reconnaissant
toutefois que les perceptions des mélomanes sont dépendantes de leurs
expériences et marottes respectives. Mais comme tous les goûts sont
dans la nature, qu’en est-il de ceux (auditeurs et musiciens) qui
ne font pas partie de la même confession musicale ? Peuvent-ils offrir
aux initiés d’un genre donné d’autres sons de cloche qui soient
pertinents, ou encore de jeter de nouveaux éclairages sur des acquis
qui relèvent de l’évidence et n’ont nul besoin d’être débattus?
Un tel exercice peut
être profitable à tous, ne serait-ce que pour nous rappeler que
la musique n’est pas porteuse de vérités inébranlables comme la
science. La Scena Musicale a décidé d’interroger trois musiciens
de chez nous à ce sujet, leur posant autant de questions par rapport
au jazz:
1-Quelle est sa
force?
2-Quelle est sa faiblesse?
3-Cette musique vous influence-t-elle d’une manière ou d’une autre
dans votre démarche artistique?
 Malcolm Goldstein Malcolm Goldstein
Violoniste, improvisateur, interprète et compositeur
1 Le jazz
demeure une musique vivante et vitale et celui-ci a produit de grands
créateurs, encore aujourd’hui. Mais tout dépend aussi de la façon
de définir le jazz. Ce que l’on enseigne à Berklee ou dans les conservatoires
de musique n’est pas du jazz, ce milieu tend à étouffer sa force
créative plutôt qu’à la promouvoir.
2 Je n’en
vois pas personnellement.
3 Le jazz,
il faut le dire, ne m’influence pas. «Influencer», qu’est-ce que
cela veut dire? Il fait tout simplement partie de ma vie comme bien
d’autres musiques, occidentales ou autres. Ornette Coleman a écrit
une pièce pour moi et je l’ai travaillée avec lui. Il faut signaler
que Montréal est une ville particulièrement propice pour la musique,
parce qu’il y a beaucoup plus de fluidité entre les genres musicaux.
Je suis installé ici depuis 20 ans et c’est beaucoup plus sain ici
pour cette raison, ce n’est pas compartimenté comme ailleurs, par
exemple en Europe, où les différents milieux sont très cloisonnés.
Ce point mérite d’être signalé.
 Michel Gonneville Michel Gonneville
Compositeur, professeur au Conservatoire de musique et d’art dramatique
du Québec
1 La force
du jazz, c’est qu’il y aura toujours, ici ou là, quelqu’un qui
arrive à nous surprendre, à nous tirer de nos habitudes d’écoute,
parfois par une seule pièce, parfois par toute une série. Cela pourrait
être aussi par sa subtilité, par un enchaînement harmonique vraiment
bien pensé, une rythmique inhabituelle, un timbre instrumental (ou
d’ensemble) attentivement mis en place... L’ouverture du jazz aux
influences extérieures donne parfois d’intéressantes pistes de renouvellement.
Rapidement imitées, à la va-vite, elles se figeront cependant à leur
tour et viendront se fondre dans le bruit musical ambiant.
2
La faiblesse du jazz, ce sont... les «standards», en l’occurrence
sa normalisation, l’institutionnalisation, les formes figées, le
manque d’imagination, d’esprit de renouvellement. La routine quoi...
On trouve parfois un certain manque de subtilité, de véritable craftsmanship,
puis une incapacité d’aller au-delà de la virtuosité technique
ou instrumentale ancrée dans des riffs faits d’avance, au-delà du
feeling... Aucun genre n’est à l’abri de ces dangers, même pas
«la musique contemporaine écrite», et surtout pas la chanson, le
«trad», la «musique du monde». Le jazz, comme les églises chrétiennes,
est bien loin de ses origines. Il est devenu un genre avec son histoire,
comportant ses «classiques», ses «maîtres», etc. – la musique
classique n’a plus l’apanage ni l’exclusivité de cette terminologie
– et ses lieux de formation (universitaire!) avec ses recettes codifiées,
etc. L’académisme le menace donc autant que tous les autres genres.
La faiblesse du jazz est dans la tête, dans les conceptions de certains
de ses représentants, qu’aucun «instinct» ne pourra complètement
sauver.
3 Comme auditeur,
j’aime toujours aller à la découverte de nouvelles propositions,
qu’elles viennent du jazz ou d’ailleurs. Très naïvement, en tant
que compositeur (je ne suis pas interprète professionnel), je me suis
approché du jazz dans l’une de mes pièces, du rock progressif ou
du «traditionnel» dans d’autres. L’important pour moi n’était
pas tant d’imiter, ou d’évoquer à la lettre, le son ou l’esprit
de la source d’inspiration que de l’assimiler, de l’intégrer
au projet de façon cohérente, proche de ma sensibilité.
 Martin Tétreault Martin Tétreault
Platiniste, expérimentateur sonore et improvisateur
1 Comme je
me sers de platines, mon rapport avec le jazz se passe majoritairement
en jouant et en mixant des disques vinyle sans égard pour l’instrumentiste,
le style et l’époque. Les solos sont donc appréciés puisque facilement
repérables et réutilisables. En ce sens, la batterie en sort grande
gagnante pour moi.
2
J’hésite à dire si c’est une faiblesse, une erreur ou une faute
de goût, mais j’ai beaucoup de difficulté avec les interprétations
«jazzifiées» d’œuvres classiques. Même arrangé par Don Sebesky,
je ne comprends pas. J’ai un malaise. Les 4 Saisons de Vivaldi par
Moe Koffman en est peut-être la cause... Mais on y trouve au moins
un solo de batterie.
3 La plus
grande influence que j’ai reçue du jazz vient de l’improvisation.
Cette connaissance s’est développée surtout sur scène au contact
des musiciens du collectif Ambiances Magnétiques. Lorsque vous apprenez
à improviser avec Jean Derome, René Lussier, Michel F. Côté, Diane
Labrosse, cette façon de faire de la musique vous marque et ne vous
quitte plus.
Propos recueillis
par Marc Chénard
La Médiathèque
Jazz du FIJM: Un an plus tard
par Marc Chénard
Ouvrant ses
portes en juin 2010, la Médiathèque Jazz/La Presse du Festival International
de Jazz de Montréal (sise au 3e étage de la Maison du festival
Rio Tinto Alcan – 305, rue Sainte-Catherine est) a récemment conclu
une entente d’acquisition des fonds du défunt ami du jazz montréalais
Len Dobbin (mort, ô coincidence! en juillet 2009 durant le festival).
Serge Lafortune, directeur de ce service, explique que la famille du
disparu a consenti à verser une large part de sa considérable collection,
celle-ci comprenant quelque:
12000 disques
compacts
400 enregistrements-cassettes de concerts et d’entrevues
600 livres (biographies, monographies, études musicologiques)
3200 exemplaires d’une quarantaine de périodiques, certains
numéros datant des années 1950
5 boîtes de documents d’archives et de communications professionnelles
3 boîtes de manuscrits et tapuscrits
quelques centaines d’artéfacts, dont des billets de spectacles,
des programmes-souvenirs de concerts tenus, entre autres, pendant l’Expo
67.
Une impressionnante
somme, il va sans dire, mais une tâche herculéenne s’annonce. «Nous
avons tout reçu pêle-mêle dans des boîtes, note M. Lafortune, près
de 120 cartons. Jusqu’à maintenant, nous avons trié et organisé
les magazines, mais le répertoriage de la collection et la mise en
ligne des informations ne sont pas prévus pour bientôt, croyez-moi.»
À l’heure actuelle, la grande majorité des objets sont rangés sur
le même étage dans sa réserve, où les archives du festival sont
également entreposées, mais on retrouve dans la salle de lecture quelques
échantillons de la collection en montre dans des vitrines.
Par ailleurs, la
Médiathèque dispose d’une bibliothèque de quelque 800 ouvrages
de référence pour consultation sur place, des disques compacts ainsi
que onze postes de visionnement donnant accès aux captations de concerts
filmées par le festival au cours de son histoire. De plus, on peut
désormais visionner gratuitement une sélection de ces documents en
version intégrale sur grand écran, soit dans la salle Stevie Wonder
(au deuxième étage), les mercredis soirs à 19h (voir le site Web
ci-dessous pour information sur les dates et concerts projetés). De
toute évidence, l’initiative mérite d’être soulignée, car en
plus de tous ses succès commerciaux remportés au cours de ses 30 et
quelques années, le festival demeure aussi une mémoire vive, sa médiathèque
contenant de réels actifs pour le patrimoine culturel de chez nous.
Heures de consultation: Mardi: 11h30 – 18 h, mer.-sam.:
11h30 – 21h, dim.: 11h30 – 17h.
Information: 514-288-8882, poste 4.
www.montrealjazzfest.com (Cliquer sur l’onglet «Maison du
festival Rio Tinto Alcan» à droite du menu.)
Au rayon du disque
par Marc
Chénard et Mark Chodan
Aventures montréalaises
Thom Gossage Other
Voices: In Other Words
Songlines SGL 1591-2 (www.songlines.com)

Depuis dix ans, le batteur montréalais Thom Gossage défriche un sentier
musical des plus originaux. Depuis 2001, il a réalisé cinq disques
à la tête de son quintette Other Voices, dont ce dernier-né sur l’étiquette
vancouvéroise Songlines. Par le passé, cet ensemble poussait sa démarche
plus loin à chaque parution, cette nouveauté étant la plus audacieuse
de toutes. Musique véritablement collective (sans tomber dans l’improvisation
totale), elle estompe avec brio la ligne de démarcation entre l’écriture
(les compos du chef) et le jeu d’ensemble, produisant une musique
de chambre qui s’éloigne de toutes les formules jazzistiques. On
félicite d’ailleurs le batteur pour avoir «expliqué» sa démarche
dans les notes du livret (et on invite aussi les intéressés à lire
une plus longue entrevue dans le site Internet du label). Aux côtés
du chef, on retrouve ses fidèles saxos (Rémi Bolduc et Frank Lozano)
ainsi que ses corythmiciens Steve Reagele (gtr.) et Miles Perkin (cb.).
Cette musique pourra en désorienter quelques-uns, mais elle appelle
vraiment à une écoute extrêmement attentive (et répétée aussi),
chose rare de nos jours où les formules convenues et les lieux communs
abondent. Impossible du reste de signaler un temps fort parmi les neuf
plages de cet album de 58 minutes, car la somme dépasse ses parties
constituantes. Autant pour la démarche que pour son exécution, cet
album (du reste bien enregistré et mixé) mérite une bonne demi-étoile
de plus. MChé
Tilting: February
9, 2011
Autoproduction de l’artiste

Le contrebassiste Nicolas Caloia est un organisateur de projets de tous
genres, parmi eux sa très grande formation, le Ratchet Orchestra (30
musiciens). Plus modeste, son quartette Tilting compte trois autres
hardis complices, soit Jean Derome (saxos baryton et alto, flûte basse),
le discret pianiste Guillaume Dostaler et le batteur polyvalent Isaiah
Ceccarelli. Ni nostalgique, ni passéiste, ce disque nous rappelle pourtant
à un certain jazz des années 1960, son esthétique se situant au carrefour
du hard bop – par ses thèmes d’une facture assez simple et d’une
pulsation rythmique nerveuse – et d’un free jazz originel caractérisé
par de longs solos énergiques mais pas débridés. Sous-tendu par la
basse insistante, Derome se montre particulièrement pugnace dans ses
interventions, réservant dans la troisième (Stare) un moment de répit
à la flûte, jouée en mode ballade. Enregistré en février dernier
dans une de nos maisons de la culture, cet ensemble est mû par une
singulière urgence qui manque trop souvent dans les prestations de
jazz d’aujourd’hui, un atout qui fait de lui un héritier direct
du free bop. On apprécie que la musique ne soit pas trop léché, mais
rugueuse à souhait, ce qui lui donne sa sève essentielle. Pour se
procurer cette galette, on vous recommande fortement de le voir avec
ses consorts en spectacle. MChé
Pianos new-yorkais
Matthew Shipp:
The Art of the Improviser
Thirsty Ear THI 57197 (www.thirstyear.com)

Depuis le début de sa carrière dans les années 1980, le pianiste
Matthew Shipp est souvent comparé à Cecil Taylor. Certes, ni l’un
ni l’autre n’a la langue dans sa poche quand s’agit de parler
de son art, et ils sont des chefs de file incontestables dans le post-free
jazz, mais il n’y pas vraiment d’autres points de comparaison entre
eux, surtout en matière de style. (Certains souligneront le fait que
les deux sont illustrés autant à la tête de leurs propres groupes
qu’en jouant sans accompagnement aucun, mais les comparaisons finissent
là.) Cet album de deux CD est justement consacré à ces deux aspects
de Shipp. Pour le premier disque, il est en trio avec Michael Bisio
(bassiste) et son ancien collègue du quatuor David S. Ware, Whit Dickey
(batterie), alors que le deuxième nous le présente seul, en concert.
La musique de Shipp est constituée le plus souvent de blocs sonores
entre lesquels l’improvisation vient établir un dialogue. Le concert
entendu ici consiste en une suite de pièces de son cru les mieux connues,
reliées par des improvisations que le pianiste lui-même décrit comme
une sorte de canalisation du cosmos. C’est une performance remarquable,
dans laquelle Shipp a moins tendance à s’égarer dans des imbroglios
musicaux comme il le fait parfois. Sa musique est excessivement complexe,
et le fait qu’il arrive à s’y retrouver est un exploit en tant
que tel. Le disque du trio est aussi affirmatif. Dickey est un partenaire
sensible, mais qui évolue dans un espace sonore tout aussi complexe.
Bisio, le nouveau venu dans le trio, semble à son aise dans un rôle
de soutien lyrique, surtout quand Shipp explore le registre grave. Comme
d’habitude, M.S. s’impose d’une manière indubitable. et cela
me rappelle un autre musicien de la même trempe… C.T., justement.
MCho
Craig Taborn:
Avenging Angel
ECM 2207 (www.ecmrecords.com)

De temps à autre, on reçoit un disque qui rafraîchit le genre et
où le musicien lui-même se renouvelle. Craig Taborn est connu pour
avoir été le pianiste du quartette fulminant de James Carter dans
les années 1990. Depuis qu’il s’est établi à New York il y a
dix ans, Taborn s’aventure dans de nouvelles voies, le plus souvent
comme accompagnateur. Après deux enregistrements en trio avec piano
et l’un en quatuor aux forts accents électroniques, son quatrième
disque, Avenging Angel, est une offrande en solo admirable dont la prise
de son splendide est digne de l’étiquette ECM. Taborn est un musicien
doué d’une telle facilité qu’il court souvent le risque de se
fier à sa technique éblouissante au lieu de s’adonner à de réelles
explorations musicales. La beauté de cette performance tient à son
humeur fantaisiste et à son refus conscient de toute virtuosité indue.
Plusieurs morceaux sont très sobres, donnant l’impression qu’il
effleure à peine les crêtes des masses sonores sous-jacentes. D’autres
pièces abordent une technique de contrepoint que l’on trouvait déjà
dans des enregistrements précédents (improvisation sur des motifs
rythmiquement complexes). L’humeur générale est introspective, avec
des abysses sous la sérénité de surface. J’y perçois des traces
du phrasé de Lennie Tristano et une utilisation du langage harmonique
de Messiaen et de Ligeti mais j’entends d’abord et avant Taborn.
Hautement recommandé. MCho
Traduction:
Anne Stevens
Tonalités torontoises
par Alain
Londes
Fern Lindzon:
Two Kites
Iatros 2011 (fernlindzon.com)

L’album de la chanteuse Fern Lindzon transmet un sentiment de détente
lyrique. Elle a assemblé une splendide collection de chansons et l’atmosphère
s’installe dès les premières mesures de la pièce d’ouverture,
Distance. Lindzon est parfaitement au diapason avec ses musiciens, particulièrement
le saxo ténor de Mike Murley. Des nombreux morceaux composés par Antonio
Carlos Jobim, Two Kites est un petit joyau méconnu dont les paroles
sont en anglais. Cette excellente chanson titre évoque l’espace,
l’air et la liberté, une zone libre imprégnée de cette idée que
«nous pouvons voler». Lindzon s’occupe des textes pendant que ses
musiciens prennent leur envol au cours d’un chorus ondulant aérien
dont la ligne mélodique n’est pas sans rappeler Four de Miles Davis.
La bossa nova resurgit avec une composition originale, All Fall Down,
puis At Quem Sabe de João Donato, chantée en portugais. Dans Moon
In the Sky, le piano délicat de Lindzon, soutenu par la contrebasse
de George Koller, sous-tend les paroles écrites par la chanteuse, après
quoi on glisse aisément dans le swing 4/4 de My Romance de Rodgers
et Hart. La mélodie yiddish Dona Dona se déploie sur une rythmique
élargie en 11/4, le tout couronné par le splendide lyrisme de Murley
au saxo soprano. Bill Evans est une grande inspiration pour Lindzon,
comme on peut le constater dans son approche pianistique dans Grey Green:
bien qu’il y ait une affinité avec Blue and Green, elle y ajoute
une touche toute personnelle. Par la suite, un mélange infectieux de
vieux klezmer et de jazz contemporain se fait entendre dans Yam Lid,
un prélude à la dernière plage, la chanson pop des années 1970 If
He’s Ever Near. Dans l’ensemble, ce disque parvient à un bel équilibre
entre la voix charmeuse de Lindzon et le soutien de ses excellents musiciens.
Ce disque résonne donc comme un message d’amour, bien nécessaire
de nos jours.
Mark Segger Sextet:
The Beginning
18th Note Records 2011 (marksegger.com)

Par définition, l’avant-garde s’éloigne des sentiers battus, alors
que les auditeurs sont invités à fixer leur attention sur une musique
imprévisible. Le batteur Mark Segger a assemblé des musiciens aux
horizons divers qui font appel à un large éventail de textures pour
donner au groupe une empreinte sonore qui ne glisse jamais dans la cacophonie.
Avec ce premier album, Segger, originaire d’Edmonton, semble bien
préparé à s’affirmer dans sa ville adoptive. Le sextette, qui comprend
Jim Lewis (trompette), Chris Willes (ténor ou clarinette) et la femme
du batteur Heather (trombone) sont appuyés par le chef, le contrebassiste
Andrew Downing et Tania Gill au piano, voire au mélodica. L’oreille
étant naturellement attirée par la structure, Steam Engine offre d’abord
aux auditeurs des répétitions réminiscentes dudit moteur. La plupart
des morceaux restants échappent à la redite en incorporant diverses
vignettes abstraites. Part III contient quelques bribes sonores évoquant
certaines trames sonores d’antan de films de James Bond, enrichies
cependant par une complexité plus jazzée; à l’écoute, on a l’impression
que les musiciens assemblent un cube de Rubik comprenant de multiples
mélodies et contrechants S’inspirant des rythmes de la soca issues
de Trinidad et Tobago, Segger laisse ses musiciens se lancer librement
dans Soca You Play It, notamment, dans un solo de Jim Lewis ou dans
un enchevêtrement de lignes en motions parallèles ou contraires des
cuivres. À l’opposé, la plage titre est une étude contemplative
en sostenutos de la contrebasse et du piano, ponctuée de nouveau par
les cuivres qui entrent indépendamment les uns des autres. Le morceau
se transforme en une séquence rêveuse de combinaisons instrumentales
distinctes qui suggèrent de vastes paysages sonores. Cet album marque
un véritable «début» pour Segger, un jeune instrumentiste et compositeur
canadien talentueux qui vient de présenter ce projet à l’Off Festival
de jazz de Montréal le mois dernier.
Traduction:
Alain Cavenne
English Version... |
|