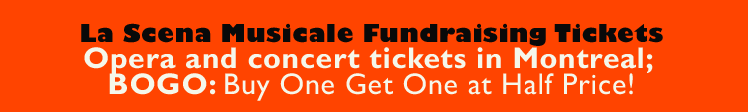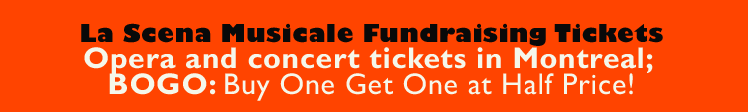Réflexions Denys Arcand Par Wah Keung Chan & Lilian I. Liganor
/ 16 décembre 2007
English Version...
L’Âge des ténèbres,
le nouveau film de Denys Arcand, s’ouvre sur une séquence onirique.
Le héros rêve qu’il chante le rôle titre dans un opéra obscur
du 18e siècle. « C’est moi, reconnaît Arcand. Les gens qui chantent
sous la douche s’imaginent tous sur une scène d’opéra. » Le rôle
en question est un rôle de ténor, bien sûr, et Arcand, avec sa voix
de basse, ne pourra jamais qu’en rêver. À 67 ans, le cinéaste projette
depuis toujours, et habilement, une part de lui-même dans ses films.
Opéra et musique sont des fils
directeurs qui courent dans toute la vie d’Arcand. Sa mère a appris
le piano et la guitare classique à l’école des Carmélites. L’aîné
de quatre enfants, Denys grandit à Deschambault, un hameau de 800 habitants
situé à 40 km au nord de Québec. Son père, pilote de rivière, adore
l’opéra et transmet sa passion à son fils. Mieux, le grand ténor
québécois Raoul Jobin était un camarade d’école du père de Denys,
et rend souvent visite aux Arcand. « Jobin vocalisait dans la salle
de bains. Il avait une immense voix. »
En 1953, la famille transporte
ses pénates à Montréal, le père voulant assurer une bonne instruction
à ses enfants. « C’est alors que les arts sont entrés dans ma vie
», dit le cinéaste. De 16 à 20 ans, Denys fréquente un collège
tenu par les Jésuites, voisine de l’église qui deviendra plus tard
le Théâtre du Gesù, où se donnaient des spectacles. Le garçon se
faufile dans la salle avec ses copains le plus souvent possible. En
dehors des classes et du hockey, il chante dans la chorale, fait du
théâtre, rédige des articles et dessine pour le journal du collège.
« Je n’ai jamais excellé dans les sports, et je n’étais pas sélectionné
pour les attaques à cinq. Mais j’avais un talent naturel pour le
théâtre et l’écriture. Je me souviens d’avoir vu La Nuit des
rois, j’en ai eu le souffle coupé. »
Arcand, qui avait envie d’écrire
des romans ou éventuellement de faire des films, n’était pas assez
sûr de son talent pour se lancer. À l’époque (1961), bien peu d’artistes
pouvaient vivre de leur art. De plus, il craignait de décevoir son
père. Il s’inscrit à l’université, optant pour l’histoire,
« intéressante sur le plan intellectuel » et qui débouche sur diverses
carrières professionnelles. Sitôt décrochée sa maîtrise ès arts
de l’Université de Montréal, l’Office national du film l’engage
pour faire des films documentaires sur l’histoire du Québec pour
sa clientèle scolaire.
« Personne ne savait comment faire
des films en arrivant à l’ONF. J’ai reçu là une bonne et rigoureuse
formation. Durant un an, j’ai passé un après-midi par semaine à
m’initier au fonctionnement de la caméra, au développement des pellicules
et au montage. On apprenait le métier en tournant un premier film.
C’était de l’apprentissage sur le tas. J’assistais à beaucoup
de tournages et de montages, j’observais pour mieux comprendre les
choix des cinéastes, les techniques de mixage. C’était le studio
hollywoodien du temps, avec de l’équipement professionnel et des
installations de montage.
Le succès ne se fait pas attendre.
Le deuxième film d’Arcand, un documentaire à vocation scolaire de
25 minutes sur Samuel de Champlain, est couronné Meilleur court métrage
pour enfants. Les films se succèdent. Au bout de quatre ans, le cinéaste
quitte l’ONF pour aller tourner à l’Expo 67. Il revient ensuite
passer encore quatre ans à l’ONF, mais comme pigiste. De 1968 à
1970, Arcand travaille à son premier long métrage, On est au coton,
un ardent réquisitoire sur la condition des travailleurs de l’industrie
québécoise du textile. L’ONF bloque la sortie du film pour des motifs
politiques et par crainte des poursuites. La controverse qui s’ensuit
propulse Arcand à l’avant-scène. « Nous en avons tiré un
vidéo et l’avons fait circuler dans tous les médias de même que
parmi les intellectuels. Par contre, les travailleurs des Cantons de
l’Est qui faisaient l’objet du film n’y avaient pas accès. Si
la situation ne m’a pas trop perturbé, c’est que j’étais très
en demande à ce moment-là. »
Arcand quitte finalement l’ONF
pour faire du cinéma de fiction. Il joue dans Mon
Œil, de Jean-Paul Lefebvre, qui lui demande de tourner un long
métrage, son premier. La Maudite Galette porte sur une bande
de tueurs. Le scénario est de Jacques Benoît, mais Arcand y met la
main. « C’était un film très violent, une espèce de B movie
avec de vagues idées sur l’absurdité de la vie, concède Arcand.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour la première fois avec
des comédiens, à capter, à adapter la réalité. Je partais de l’idée
qu’il fallait nous entraider. Cela ne présentait pas de difficultés
pour moi. » De ce jour, à l’exception de Love and Human Remains,
Arcand a signé tous les scénarios de ses films. « Je n’en recevais
pas de bons. Je n’ai jamais eu de chance avec les scénarios tout
faits », explique-t-il.
C’est en tournant un film sur
Maurice Duplessis que Denys Arcand trouve le sujet de son film suivant,
Réjeanne Padovani, une histoire de corruption politique. Sur les
parvis d’église et dans les assemblées politiques, il avait remarqué
des chauffeurs privés de ministres, policiers de jour, en grande conversation
avec des individus du monde interlope, chauffeurs aussi. « Comme ils
parlaient de voitures, je me suis dit qu’ils se connaissaient sans
doute, qu’ils étaient en relation d’une façon ou d’une autre.
Cela m’a donné l’idée du dîner. » Dans le film, Vincent Padovani,
un louche baron de la construction, reçoit à dîner un maire et un
ministre à qui il doit un contrat routier. « L’intrigue m’est venue
peu à peu. J’ai imaginé un Padovani séparé de sa femme qui vit
aux États-Unis. À partir d’un embryon d’histoire comme celui-là,
on sort sa plume et on travaille comme un fou. » Arcand, qui avoue
souhaiter depuis longtemps faire de la mise en scène d’opéra, se
fait plaisir en introduisant une touche lyrique dans son film : « Comme
le maire adore l’opéra, Padovani engage une très belle soprano pour
chanter un extrait de l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck,
J’ai perdu mon Eurydice. Le maire tombe sous le charme.
Le film traite de contrôle et de contrats. »
D’une nature franche et directe,
Arcand aborde de front les sujets politiques. « Dans les questions
sociales, il y a toujours un aspect politique. Le Québec a traversé
une période très politique. Il y a eu le FLQ et les bombes, puis le
drame de Kent State University et la guerre du Vietnam. Puis l’arrivée
au pouvoir du PQ en 1976. Mes films n’ont jamais été militants,
mais la réalité de l’époque elle-même était politique. En 1980,
j’ai réalisé un film sur le référendum pour l’ONF, mais plus
rien de proprement politique par la suite. »
Avant Le Déclin de l’empire
américain, l’immense succès de 1985 qui jette un regard cynique
sur les valeurs sexuelles de la société québécoise, Arcand traverse
des années de vache maigre. Avec ce film, tout allait passer ou casser.
« À 45 ans, pendant la production du Déclin, je me trouvais
à un carrefour. Si ce film n’avait pas réussi, j’aurais aussi
bien pu abandonner le métier. » La situation de Denys Arcand aurait
été tellement précaire, dit-on, que l’échec du Déclin
aurait pu le contraindre à vivre beaucoup plus modestement, sinon à
frapper à la porte de l’Armée du salut. « Je n’aurais peut-être
plus trouvé de travail. Le Déclin a marqué un moment très
important dans ma vie. Grâce à ce film, je pourrai continuer à faire
du cinéma pour le reste de ma vie dans une certaine aisance. » Arcand
précise qu’il a fait des tournages commerciaux après le Déclin,
qui l’ont aidé à payer son appartement. » À quoi Arcand attribue-t-il
ce succès ? « À la chance. J’ai travaillé aussi fort sur tous
mes autres films. Celui-là est arrivé juste à point. Le public s’y
est reconnu. Les gens voulaient voir ce film-là précisément
à ce moment-là. » Deux ans plus tôt ou deux ans plus tard,
dit Arcand, son film aurait très bien pu rater sa cible.
En 1989, Jésus de Montréal
vient rehausser encore le palmarès d’Arcand. L’idée maîtresse
du film lui vient pendant qu’il auditionne des comédiens pour un
tournage. L’un deux s’excuse de porter la barbe, expliquant qu’il
joue le personnage de Jésus à l’Oratoire Saint-Joseph. « Je suis
allé à l’Oratoire et j’ai vu là des acteurs dans une production
médiocre acclamée par les touristes. J’ai décidé que je devais
faire un film. »
Arcand préfère plancher sur un
film à la fois. Le scénario du Déclin lui a demandé deux
ans de travail, celui de Jésus de Montréal, un.
« J’ai commencé Les Invasions barbares en 1992; j’en
ai fait deux versions, toutes deux insatisfaisantes. » Dix ans plus
tard, le cinéaste trouve la solution qu’il cherche en ramenant à
l’écran les personnages du Déclin américain.
Persévérant et consciencieux,
le cinéaste apprend son métier. « Au début, je ne connaissais rien.
J’ai tourné mon premier film en 35 mm avec une seule lentille et
une caméra fixe. Je me suis initié progressivement, par choix, au
fonctionnement de chaque composante. » Arcand tourne en noir et blanc
avant d’opter pour la couleur, dont il exploite maintenant « la pleine
palette ». Une avancée qu’il bénit est la vitesse de déroulement
de la pellicule vierge. La caméra steady-cam, dont il s’est servi
dans ses trois derniers films, est pour lui « une révélation
», « un bonheur ».
Bien qu’il se soit longtemps
réservé le travail de montage, Arcand le confie maintenant à une
collaboratrice. La mine un peu contrite, il avoue : « Je me pointe quand
même dans la salle de montage tous les jours mais il arrive qu’on
me demande de m’en aller. C’est mon film, c’est ma vie ! » Arcand
croit néanmoins qu’à travailler en solitaire, on risque de se retrouver
« tout seul avec son talent » et que la collaboration est un enrichissement
autant pour le film que pour ses artisans.
C’est dans les Laurentides que
le cinéaste trouve la quiétude dont il a besoin pour rédiger ses
scénarios. Il y travaille du lundi au vendredi, seul dans son chalet,
ne rentrant à la maison que les week-ends. L’été, il fait relâche
(« l’été n’est pas fait pour travailler »). Sa discipline personnelle,
son intégrité professionnelle, l’austérité de son existence pendant
qu’il écrit sont remarquables. « Il me faut trois mois pour le scénario.
Trois mois de calme et de concentration totale. Je n’ai pas d’ordinateur
et je ne réponds pas au téléphone. »
Arcand n’a pas de comédiens
particuliers en tête lorsqu’il crée ses personnages. « Nous prenons
une page de texte et nous l’envoyons à plusieurs acteurs pressentis
pour un rôle principal. Le directeur du casting apporte une caméra
aux auditions. Nous enregistrons les prestations des candidats, ensuite
je visionne le tout à la maison. Il y aura plusieurs mauvaises scènes
puis, soudain, une prise parfaite. Tel acteur est le personnage.
Il dépasse ce que j’avais imaginé, y ajoutant le fruit de son expérience,
de sa sensibilité. Il enrichit le scénario.
Avec Les Invasions barbares,
qui a remporté un Oscar en 2003, Arcand explore le sujet douloureux
de la mort. Dans une entrevue pour le magazine MacLean’s, la
même année, il livre ses réflexions sur les maladies mortelles et
l’euthanasie. Sa fille Mingxi, une petite Chinoise qu’il a adoptée
il y a dix ans avec sa femme et collaboratrice Denise Robert, est à
l’origine de ces préoccupations. « Avant son arrivée, je ne m’occupais
pas de ma santé. Maintenant, je me dis que ma fille aura besoin de
moi pendant dix ans encore. Je veux être présent pour elle, je veux
l’équiper pour faire face à la vie. » Arcand s’attendrit quand
il évoque sa jeunesse. » Il y a eu des moments de tendresse dans mon
enfance. Je les avais oubliés. Maintenant j’aimerais en faire un
film, un film plutôt gentil et optimiste. » Il y a déjà pensé puisqu’il
continue : « Je mettrais en scène un type qui évoque ses souvenirs.
Qui serait-il ? Probablement un architecte. Les architectes ont des
points communs avec les cinéastes, ils construisent, ils sont créatifs.
» D’ailleurs, s’il avait été meilleur en mathématiques, Arcand
se serait peut-être tourné vers l’architecture au lieu du cinéma.
Il a récemment visionné un documentaire sur la profession et se propose
de rencontrer des architectes dans le cadre de ce futur projet
Devant une feuille de route aussi
éclatante, il est presque rafraîchissant de trouver au grand homme
des défauts. Avec sa franchise habituelle et sans se troubler, Arcand
avoue être « un très mauvais professeur. J’ai donné des cours
à l’UQAM et à l’Université Laval pendant six mois. Dans
les deux cas, les étudiants sont allés chez le doyen réclamer mon
congédiement. » Il déplore le fait que les jeunes préféraient parler
du Festival de Cannes que de photographie en classe. « Il faut commencer
à zéro, expliquer pourquoi, avec une lentille courte, la profondeur
de champ sera large et longue, et pourquoi, avec une longue lentille,
la profondeur est courte. Ce qu’on demande à un acteur dépend de
l’objectif monté sur la caméra. Les très grands acteurs vérifient
ce genre de choses. Il faut toute une vie pour les apprendre. »
Les premières critiques de
L’Âge des ténèbres, présenté à Cannes en mai dernier, ont
été mitigées. Arcand ne semble pas s’en soucier outre mesure, lui
qui a déjà récolté toutes les récompenses possibles. Le tiers environ
de son budget provenant des fonds publics, il a la liberté de faire
ce qu’il veut. Le cinéaste n’aime pas modifier ses films de fond
en comble. « Je veux bien faire plaisir aux gens, mais je veux aussi
leur montrer la vie. » Cela ne l’a pas empêché, toutefois, de suivre
un conseil reçu à Cannes et de raccourcir une scène de trois ou quatre
minutes en vue de la première de L’Âge des ténèbres, le
7 décembre à Québec.
Dans ce film, c’est Rufus Wainwright
qui incarne le chanteur d’opéra. Un choix qui peut paraître étrange.
« Ma théorie, c’est que les gens qui chantaient de l’opéra [au
18e siècle], étaient des acteurs, comme ceux des comédies musicales
aujourd’hui. Je cherchais un acteur sans formation vocale particulière
mais qui ait de la musicalité. Rufus Wainwright est très bon. Il chante
un deuxième air à la fin du film. » À entendre Arcand parler d’opéra,
on se demande pourquoi il n’a pas encore signé de mise en scène
lyrique. « Je n’aime pas trop Wagner. » Sinon, il aurait participé
à la production du Ring à la Canadian Opera Company. Il rit :
« J’aime les opéras de Haendel, mais les livrets sont idiots ! »
Tout n’est pas perdu cependant car le cinéaste ajoute : « Je n’ai
pas encore trouvé le bon opéra, c’est tout. » Peut-être qu’il
devrait en écrire un ! n
[Traduction : Michèle Gaudreau]
ses 5 FILMS PRÉFÉRÉS (SANS ORDRE
PARTICULIER) |
›
-Akira Kurosawa, Les Sept samuraïs.
Pour le scénario, la façon dont il est tourné.
›
-John Ford, L’Homme qui tua Liberty Valance.
Un film absolument parfait.
›
-Luchino Visconti, Le Guépard.
La fin de l’aristocratie italienne. Visconti était aussi un grand
metteur en scène d’opéra.
›
-Ingmar Bergman, Le Silence et Scènes de la vie
conjugale. D’une grande profondeur.
›
-Luis Buñuel, Le Charme discret de la bourgeoisie.
D’un surréalisme total. Un film parfait.
|
English Version... |
|