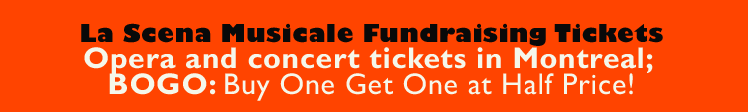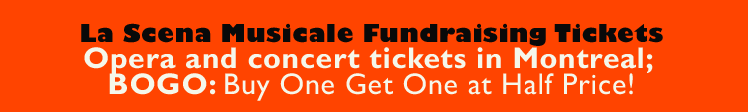Glenn Gould : Histoire de style Par Stéphane Villemin
/ 3 octobre 2007
Si
tout le monde s’accorde à dire que Glenn Gould était un pianiste
hors du commun, la question de son style provoque les réactions les
plus diverses, allant de l’adoration jusqu’à l’aversion la plus
tenace. Le fait est que les fortes personnalités ne laissent jamais
indifférent, car elles transcendent la normalité en faussant
les repères et en questionnant les critères de catégorisation. Glenn
Gould n’a pourtant pas consacré sa vie à débusquer des mythes ou
à combattre des idées reçues, il l’a sacrifiée sur l’autel du
style, de son particularisme, de son idiosyncrasie. Glenn Gould était,
il ne cherchait pas à être. Son style n’était pas forcé, il émanait
de sa personnalité comme une lave jaillit d’un volcan en activité
et sans relâche.
À notre époque où les notions
d’écoles pianistiques se sont estompées et où les styles
sont devenus plus ou moins interchangeables dans le meilleur des cas,
inexistants dans le pire, Glenn Gould fait figure de martien dont la
singularité dérange. Malade, il l’a été dans le sens médical
du terme, mais le cas psychosomatique de ce grand consommateur de pilules
relève d’une plus grande complexité. S’il valait par ce qui le
différenciait des autres, il était sûrement atteint de la « maladie
de valeur » dont parlait Gide. En d’autres termes, ses ailes de géant
l’empêchaient de voler, pour paraphraser Baudelaire.
En tant qu’être engagé, il
a mis en œuvre tous les moyens d’expression susceptibles d’extérioriser
son combat intérieur : l’interprétation pianistique, la composition,
le pamphlet, le théâtre, le monologue, l’art de l’enregistrement
ainsi que l’enregistrement de l’art, mais aussi les émissions de
radio dont il devenait le producteur d’un soir pour la CBC. Loin d’être
de simples biographies ou des panégyriques, ses portraits radiophoniques
de Schoenberg, Casals, Stokowski et Strauss s’avéraient des prétextes
au partage des concepts philosophiques qui le hantaient. Dans sa
Trilogie sur la solitude, il explore aussi les thèmes du silence,
du nord et de l’horizontalité qui lui sont chers.
Forcément capricieux, impalpable,
obscur ou abscons pour le béotien, le pianiste ne cherchait pas à
cultiver son style en portant écharpe, gants et foulard en plein été.
Ce que d’aucuns pourraient tenir pour du folklore n’était que le
haut de l’iceberg d’une personnalité dotée d’une sensibilité
exacerbée et d’une intelligence hors du commun. Lorsqu’un artiste
se confond à ce point avec ses idées, le résultat ne peut être qu’exceptionnel.
Chez Gould, l’art et la manière
sont intimement liés à l’énergie intérieure qui l’a animé pendant
les cinquante années de sa vie. Comment pouvait-il faire preuve d’autant
de virtuosité au clavier avec une technique aussi contraire à l’anatomie
? Sans doute qu’en se tenant droit, sur un banc un peu plus haut,
il se serait senti plus loin de la matière musicale. Mais tout fonctionnait
à merveille grâce à sa force intérieure qui le propulsait dans un
état de transe et d’extase. À quoi sert le vêtement corporel pour
un être dont l’âme exacerbée déborde à tout instant ?
Naturellement, il a dû compenser
artificiellement les mauvais traitements infligés à son corps, non
par masochisme, mais par pure négligence : séance de mains et de bras
passés à l’eau chaude, médicaments, jusqu’au moment où l’équilibre
instable s’est rompu, un jour après son cinquantième anniversaire.
Inimitable vie, personnalité unique,
tout pour le style et rien pour le monde matériel. Glenn Gould serait-il
le Dorian Gray des pianistes ?
Qu’en pensaient
les Russes ?
Lors de sa première tournée européenne
en 1957, Glenn Gould alla jouer en URSS. Pour son premier concert à
Moscou, il n’y avait que quarante personnes dans la salle. Après
l’entracte, il n’y avait plus une place où s’asseoir. Doués
d’une remarquable sensibilité musicale, les Russes voulurent ce soir-là
faire partager à leurs amis la légende du pianiste qui jouait de la
musique comme personne ne l’avait fait avant lui. Après l’avoir
entendu, le plus grand pédagogue russe de ce siècle, Heinrich Neuhaus
, affirma : « Sa façon de jouer Bach donne l’impression que le compositeur
lui-même a pris place au piano. »
Les fameuses Variations Goldberg
Gould fit ses débuts aux États-Unis
le 2 janvier 1955 à Washington, puis le 11 janvier de la même année
au Town Hall de New York. Ce dernier récital aurait pu passer totalement
inaperçu, n’était la présence de David Oppenheim, directeur de
la Columbia, venu un peu par hasard. L’affiche annonçant un programme
Gibbons, Sweelinck, Bach, Weber, Beethoven et Berg, interprété par
un pianiste inconnu, ne risquait pas d’ameuter les foules. Le lendemain
même, un contrat était signé avec sa maison de disques de toujours,
pour laquelle il allait réaliser plus de soixante enregistrements.
Le premier d’entre eux fut le tremplin de la carrière internationale
de Gould. Les Variations Goldberg de Bach, enregistrées en juin
dans une ancienne église presbytérienne servant de studio à la Columbia,
firent le tour du monde et précédèrent Gould lors de sa première
tournée européenne en 1957. Les plus grandes salles, les plus grands
chefs, et les plus grands cachets dit-on, s’offrirent au pianiste
canadien. En 1981, il bouclait son entreprise en réenregistrant les
Variations Goldberg au même endroit, vingt-six ans après. Un des
jeux favoris de la critique consiste à comparer les deux versions... n |
|