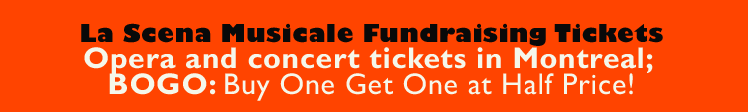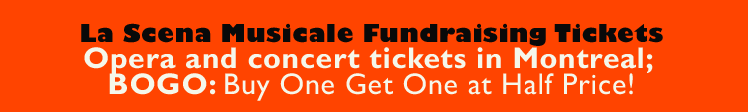[N.B. : Les passages marqués en italique sont ceux
reproduits dans la version imprimée de ce magazine.].
La Scena Musicale : Messieurs, votre groupe (qui
était en concert le deux juillet dernier dans le cadre du Ferstival
international de jazz de Montréal, n.d.r.) a-t-il été conçu strictement pour la
scène ou y-voyez-vous un genre de projet conçu en fonction de la publication
éventuelle d’un disque ?
Louis Sclavis : Quand on fait de la musique, c’est
pas toujours pour faire un disque. Je veux dire que la vie ce n’est pas le
disque. Le disque, c’est la carte postale d’un moment donné, mais pour nous ce
n’est pas la chose importante. Ce qui est important, c’est d’être en scène, en
face des gens. La chose importante dans cette musique, c’est le moment unique,
mais le disque a bien son intérêt après coup, mais nous notre plaisir à nous
c’est d’être sur scène et de jouer devant les gens, mais le disque vient après,
et c’est autre chose. On ne fait pas cela pour faire des disques. De temps en
temps, on est fait tous, ça nous est utile, mais je veux dire que notre vrai
plaisir c’est le concert. C’est quand même l’une des choses les plus précieuses,
d’être devant des gens, sinon on n’a aucune raison de se déplacer comme cela, de
traverser l’Atlantique. Si le concert n’était pas essentiel pour nous, on
enverrait alors un disque.
L.S.M. : Vous vous connaissez quand même depuis
longtemps, 25 ans sinon plus. À quand remonte votre première rencontre
musicale ?
Michel Portal : Je pense
que que mes premières rencontres ont été avec Daniel Humair et Henri Texier et
Louis est arrivé par après. On a commencé par faire de la musique à l’époque de
ce que l’on appelait les musiques ouvertes, à la fin des années 60. On se
réunissait parfois avec Aldo Romano, c’était en 1968, et on faisait des
expériences de musiques ouvertes, surtout improvisées. Il y avait très peu de
thèmes et je pensais que c’est comme cela qu’on s’est rencontré, d’abord avec
Henri, puis Daniel est arrivé là aussi.
L S : Oui, c’était la période après. Il y avait la
fin des années 60 puis, dans les années 70, je suis arrivé dans le mouvement
juste après.
L S M : Michel Portal, vous avec été témoin de
cette période-là, mai 68, et vous avez y avez participé directement en tant que
musicien.
M P : Les débuts de
cette musique-là se se sont créés en relation aux rapports sociaux, politiques
et je ne sais quoi d’autre. À cette époque, je faisais du studio
d’enregistrement, accompagnant des chanteurs et chanteuses, et on en avait ras
le bol souvent. Toutefois, je n’étais pas quelqu’un qui jouait dans les clubs,
j’y allais plutôt écouter des musiciens, comme au Club St-Germain, mais je
n’avais ni la force, ni le courage. Peut-être suis-je négatif dans ce que je
dis, mais l’ouverture s’est créée avec l’arrivée des les musiciens américains
qui venaient jouer à Paris, par exemple ceux du Art Ensemble of Chicago qui,
eux, étaient très importants pour nous, puisqu’ils nous ont donné un petit peu
cette force d’aller ailleurs et de jouer librement sans penser à tout ce qui
nous avait entourés avant, tous ces génies de la terre qui sont ceux de la
musique américaine, quoi. On a peut-être oublié de s’y opposer, ne
serait ce que d’essayer de se libérer et de jouer.
L. S.M. : Il y a eu justement cette période
marquante de la fin des années 60, mais chose intéressante, ce qui amené cette
réaction-là, c’est quand même un style qui s’appelait le Free
Jazz.
M.P. Ce n’était pas un
style américain, c’était des gens qui en avait un peu marre de ressembler un peu
à l’autre et qui ne voulaient plus copier ou imiter, mais qui voulaient
s’affirmer et dire qu’on existait quand même un peu. Et c’est comme cela que,
doucement, dans ces groupes-là, sont arrivées quelques compositions originales,
mais qui étaient très rares auparavant parce qu’on jouait les standards et il y
avait très peu de répertoire, même dans les clubs. C’est une autre école, quoi,
le fait de jouer le chorus et de dire qu’il a bien joué, ou non, c’était
toujours noté et très difficile de faire cela. Pour nous, il s’agissait très
simplement de développer des approches pour notre propre territoire et de
mélanger ce que l’on fasiait déjà; je ne sais pas, on pouvait intégrer d’autres
musiques petit à petit, que ce soit de l’Afrique ou d’autres folklores, même des
chansons. Pourtant, cela a été aussi très douloureux. Cela n’a pas été facile.
On ne faisait pas de la musique free comme cela, en sortant de là en disant
qu'est-ce qu’on s’est marré. Non. Il y avait plutôt une tension extrême. Je
pourrais dire qu’il y a des musiciens qui étaient très mal dans cette période,
parce qu’on pourrait penser que de pouvoir jouer dans la liberté, ça donne la
joie, mais finalement on sortait de là en disant ´ Qu’est ce qu’on a foutu
encore ? ª À partir du moment où on a fait un disque qui s’appelait
´ Free Jazz ª avec François Tusques, on a écouté et on a été effrayé
en même temps, et pas très content non plus. Mais cela ne voulait pas dire qu’on
aurait continué avec ces mêmes musiciens.
L S M : Et c’était aussi votre
réaction ?
M.P. C’était la réaction de tout le monde. Tout le
monde se cachait en même temps et revenait aussi. Je me souviens de Barney Wilen
qui m’appelait tout le temps en me disant : ´ Qu’est-ce que foutez
là ? Vous déconnez ou quoi ? Qu’est-ce que cela veut
dire ? ª. Je me rappelle un jour, où il m’a dit : ´ Je
voudrais bien venir avec vous une fois, mais tu crois que je fais le
poids ? ª Tu te rends compte ? Et il n’est jamais venu. C’est
dommage, parce que je crois que, ce musicien-là, aurait pu nous donner tout ce
qu’il savait. Je crois que je pourrais parler de ce qui peut arriver
aujourd’hui, comme le concert d’hier soir qui n’était pas loin de ce qu’on
pratiquait parfois dans la free, mais aujourd’hui c’est une autre époque parce
que les compositions sont arrivées, ce qui est bien d’ailleurs. Je me souviens
que ces musiques étaient longues, on jouait deux ou trois heures, on était très
fatigué parce qu’on ne voulait pas jouer la composition. Alors, au bout de 20
minutes, les mecs étaient complètement crevés et ils se disaient :
´ Putain qu’est ce que je vais faire demain? ª Il y en avait un qui
posait la contrebasse, qui partait, revenait et qui n’en pouvait plus en
disant : ´ Mais qu'est-ce que c’est que cela ? ª Il y avait
une espèce de mouvement, de continuum. Mais tout cela s’est calmé parce que
c’est la mode qui nous a fait que… Voyez-vous, il y a des nostalgies aujourd’hui
sur le free jazz… et c’est très curieux.
L. S.M. : Et vous, comment vous sentez-vous à cet
égard ? Par exemple, est-ce que vous réécoutez des disques de cette
période-là ou non ?
M.P. Je ne réécoute même pas les choses que je fais
aujourd’hui. Quant à moi, j’espère souvent jouer, pas nécessairement dans le but
de m’améliorer, mais j’analyse chaque concert et je me dis : ´ Tiens,
j’ai fait cela hier, et peut-être vais-je rectifier certaines choses
aujourd’hui. ª Mais l’essentiel, c’est quand même de se rencontrer, comme
on fait dans le jazz, et d’essayer de développer cela à partir de petits
matériaux avec les personnalités qui sont autour. On se connaît assez bien, moi,
Louis, Daniel Humair et Henri Texier et ça peut couler très vite, c’est toujours
en action. Mais il faut dire que c’est rare de rencontrer des musiciens dans une
carrière et de les revoir toujours, même longtemps après. Il y a beaucoup de
gens qui se quittent, beaucoup même. J’ai toute une liste de gens que je ne vois
plus et je ne sais plus où ils sont.
L S.M. : Louis Sclavis, en regardant ta
discographie, je constate comme deux lignes qui se dessinent dans ton
œuvre : d’une part, il y a des projets, comme ton plus récent disque ECM
´ Napoli’s Walls ª, et on pourrait même dire que presque tous tes
autres disques sur cette même étiquette en sont des disques à projet, il me
semble; d’autre part, je note une autre tangente que je pourrais appeler ‘les
rencontres’. On pense ici à la rencontre avec Fred Frith et Jean-Pierre Drouet
(´ I Dream of You Jumping ª, les disques Victo), qu’on a vu à
Victoriaville, et, dans le passé, ton duo avec Ernst Reijsiger, sans oublier les
duos sur FMP (´ Dythirambisch ª, FM 39-40). Cela dit, j’aimerais
savoir si tu es conscient de cela toi-même et s’il y a des moments où tu
t’engages dans un projet pour ensuite te lancer à un autre moment dans ses
rencontres? Comment vois-tu ces deux mondes : se complètent-ils, sont-ils
différents l’un de l’autre ?
L S : Tout cela fait partie du même territoire. Ma
propre musique se fait à partir de ce que font tous les autres musiciens.
C’est-à-dire, on a à la fois des projets assez fixes, avec des groupes, des
répétitions, puis il y aussi ce besoin de rencontres, de faire des choses
complètement différentes. Mais on nous dit souvent, n’est-ce pas schizophrène de
faire des musiques comme cela, très différentes entre elles, que cela soit pour
un film ou juste de composer une jolie mélodie, pour alors se lancer dans une
rencontre avec un musicien pour faire un concert complètement free, ou encore
tenter des expérimentations sonores. Par ailleurs, on peut aussi participer à un
concert comme artiste invité, ou qu’on invite quelqu'un à son tour. Tout cela
pour dire qu’on me pose souvent la question de la schizophrénie en me demandant
s’il y a une unité dans tout cela. Je dois dire : oui, absolument. Parce
que ce qu’il faut voir, c’est que l’artiste, et notamment le musicien, mène une
carrière de nomade. Pourtant, le nomade est dans un territoire, donc il y a là
une unité. Ce territoire est peut-être prédéfini à l’avance, mais il va y passer
sa vie pour y éclairer des endroits, petit à petit. Mais ce n’est pas du tout
schizophrène ; au contraire, on a une vie unifiée dans ce territoire dans
lequel on se déplace. Les orchestres sont alors des lieux pour moi ; il y
en a certains par lesquels on passe souvent, d’autres moins et d’autres encore
où l’on s’arrête le temps de construire une demeure, ou un village, et de
reprendre la route pour rencontrer quelqu’un qui va donner naissance à un
nouveau lieu, et ainsi de suite. Quoi qu’il en soit, tous ces lieux se trouvent
dans un territoire. Vu ainsi, il y a donc une grande unité. Qui plus est, cette
situation est même bien normale et je pense même que la façon dont on vit notre
métier est bien plus proche de celle de la condition humaine à ses tout débuts,
soit de vivre justement en nomade dans un territoire qu’on définit. En
contrepartie, la personne qui travaille dans un bureau toute la journée et qui
n’a pas de plaisir à le faire, mais qui trouve quand même son plaisir dans un
hobby, comme aller à la pêche, être artiste amateur ou faire de la randonnée en
montagne, c’est bien là où on est dans la schizophrénie. Donc, la plupart des
gens mènent une vie schizophrène en ayant l’impression d’être normal, alors que,
nous, on vit une vie dans cette façon de se déplacer dans notre territoire de
lieu en lieu, avec la mémoire des lieux, leur localisation, des gens qu’on
rencontre, tout cela est donc très cohérent et tout à fait normal. Je dirais
aussi que notre façon de fonctionner est beaucoup plus proche de l’humanité au
départ que ce qu’elle est devenue aujourd’hui dans ce qu’on appelle une certaine
normalisation. Nous on est complètement normal et, je dirais même, qu’on se
soigne bien.
M.P. : J’ai d’autres problèmes avec cela,
certainement. Il y a ce problème de la multitude de musiciens qui est arrivée,
la multitude de disques, tout comme la multitude de musiques qu’on peut écouter
dans une journée : c’est effrayant, quoi. Quand on vous demande de faire un
disque, on vous dit : ´ J’espère que ce sera bien cette
fois-ci. ª. Vous vous rendez compte… Je ne sais pas si vous allez dans un
magasin de musiques, mais moi je ne sais plus acheter quoi que ce soit. Je vais
à la FNAC souvent et c’est comme ça : il peut y avoir toute une pile de
nouveautés qui arrivent dans la journée. Par exemple, une galette avec deux
clarinettistes basques qui ont enregistré avec deux percussions, alors je
pourrais peut-être écouter cela. Mais il y a un autre là à côté où on a fait
autre chose ici. Mais il y a un encombrement total. Mais qu’en arrive-t-il avec
tous ces disques : ils sont là une semaine pour ensuite aller doucement
vers le bas et disparaître. La problématique du disque aujourd’hui, c’est
ça : on nous dit :
´ Il faut faire un beau disque ! ª, sinon
il va disparaître dans deux secondes. Mais c’est monstrueux de faire un disque
comme cela, soit d’avoir cette prétention de faire un grand disque aujourd’hui.
Mais ça veut dire quoi au juste ? Que je prenne les meilleurs, les plus
grands et que je dise : les voilà ! Mais c’est un problème très
gravissime. Avant, on pouvait parler de styles, comme le bop, mais maintenant il
n’y a plus rien. Les gens ne savent même pas s’il faut mettre ce disque dans un
rayon jazz, rock ou autre. Les gens ne savent ne savent plus maintenant, et
c’est assez grave.
L S : C’est pour cela que le concert
est important, parce qu’il est le seul endroit où il y a un repère qui devient
simple, précis et heureux, parce que, d’un seul coup, quand le public est en
confiance avec le musicien, il ne se pose plus la question de savoir ce qu’il
est en train d’écouter, si c’est ceci ou cela ; il est en face d’une vérité
toute simple d’une organisation qui se passe devant lui. C’est cela et rien
d’autre. Soit il y prend son plaisir, soit pas, mais c’est pas compliqué. Le
rapport en scène n’est pas compliqué. Avec le disque, par contre, le rapport
n’est pas simple aujourd’hui, du moins pour nous.
M.P. : Je voulais dire une chose : comme
Henri me dirait : Négatif, mais positif, c’est qu’il faut quand même
toujours laisser des traces, c’est indispensable pour un artiste et c’est tant
mieux s’ils font des disques. Je veux dire que que ce qui est autour d’un
disque, ce n’est pas très, très clair. Parce qu’on pourrait vous dire, faites un
truc comme cela, parce que l’électronique est arrivée. Ou encore : pourquoi
faire une chose acoustique si ça ne se vend pas bien, alors que l’autre truc se
vend pas mal . Quand j’entends cela, je n’ai pas très envie, c’est tout,
quoi. Les artistes ne sont pas maîtres de ls situation dans beaucoup d’endroits
aujourd’hui.
L. S.M. : Dans le cadre d’une entrevue publiée
dans le magazine de jazz allemand Jazz Podium, vous avez déclaré, et je traduis
ici les propos, publiés en langue allemande :
´ Quand je joue, je n’exprime pas ma vie et mes
expériences. Quand tu es sur la scène, cela n’a rien à voir avec la vie. Pour
moi, il n’y a pas de lieu entre la vie et l’art. À chaque fois que je lis des
biographies de compositeurs et d’artistes et je m’aperçois des liens établis
entre l’art et la vie, je dois dire que c’est trop facile comme moyen à prendre
pour vouloir expliquer les choses. ª Compte tenu de ce propos, quels sont
donc les enjeux pour toi, musicaux ou autres, qui entrent en ligne de compte à
chaque fois que tu montes sur scène ?
L S. : Lorsque je joue et j’improvise, des
gens se demandent si je suis en train d’exprimer des sentiments, ou si je vois
des images devant moi, ou encore si j’exprime même quelque chose de ma vie. Ma
réponse à cela est non. Quand je suis sur scène, je n’exprime pas de
sentiments, je ne suis pas là en train de voir une montagne avec de la neige ou
je ne suis pas en train de dire, je suis en colère et je veux l’exprimer ou je
vais jouer un truc triste parce que je me sens malheureux. Quand on est sur
scène et qu’on improvise, il faut faire le vide total. Je ne crois pas du tout
au fait de rentrer sur scène avec plein de sentiments à exprimer. Pour moi,
c’est très mauvais d’être chargé d’émotions dans cette situation, parce qu’il
n’y a plus de place pour les autres musiciens, le public et l’aventure
éventuelle. J’estime que lorsqu’on improvise, le plus grand des travaux, c’est
de faire le vide total, alors avec une conscience très aiguisée pour être à
l’écoute, pour être très en éveil. Effectivement, on passe son cerveau au
vestiaire, mais vraiment avec aucune intention et avec le plus grand vide, un
peu comme une technique zen où il y a une conscience éveillée. Quand je monte
sur scène, je n’ai rien à dire, je ne ressens rien et, à la limite, je dis que
je n’exprime rien. Il ne faut pas oublier d’ailleurs qu’on est tellement
préoccupé par le fait de fabriquer la musique. On se sert ici d’un outil pour
faire quelque chose, il faut alors s’en occuper et être à l’écoute de ce qui se
passe. Comme on est suffisamment occupé à conduire la locomotive, on ne peut pas
se préoccuper de savoir qui sont les voyageurs. De toute façon, je trouve que
c’est pareil lorsqu’on compose. Il faut aussi faire le vide, sinon, au bout d’un
moment, on n’arrive pas à se surprendre, ou à partir sur quelque chose, parce
qu’on est bloqué par tout ce qu’on voudrait amener. Ce faisant, on ne laisse pas
la place aux autres musiciens, quitte à laisser la chance au public de respirer.
Pour moi, la création n’est pas remplie de choses, mais il s’agit plutôt de
créer un vide énorme où les choses vont arriver d’elles-mêmes et se remplir sans
trop forcer. Quand on m’explique qu’un compositeur a écrit une œuvre donnée
parce qu’il était très malheureux dans sa vie, moi je n’y crois pas. Si Malher
avait gagné à la loterie la veille, par exemple, il aurait sans doute composé la
même chose. Je ne crois pas à cette relation étroite entre le vécu et
l’expression artistique ; ce sont des choses très différentes pour moi…
Certes, il y a toujours un lien, mais il n’est pas ce que l’on impute,du
genre : ´ Ah oui, vous êtes content, alors vous jouez comme
cela. ª Il arrive que je sois très content, mais je joue quand même un truc
d’une tristesse infinie. Donc, cela n’a rien à voir. À mon avis, la création
artistique n’est pas une question d’inspiration ou d’avoir une plénitude
d’idées : tout le monde a un plein d’idées. Le plus dur, cependant, c’est
d’en choisir une. C’est ça le grand travail. Tout le monde a quarante mille
idées, mais peut-on en choisir une ? C’est ça un artiste : c’est
quelqu’un qui n’a pas plus d’idées qu’un autre, sauf qu’il a le métier pour
savoir se dire qu’il y choisira une à un moment donné. Donc, il n’y a pas de
mystère là-dedans, il s’agit d’apprendre à savoir comment choisir. En fait,
quand j’ai commencé, je ne savais pas choisir, sans doute pas plus maintenant,
mais quand même je fais l’effort de choisir. À un moment, je me dis : c’est
cela., je prends la décision de choisir, même si je ne suis pas sûr, puis on
élimine tout le reste. On fait le vide.
M.P. : Je ne suis pas tout à fait
d’accord. C’est un peu d’érectionnel que j’entends. Heureusement, les gens sont
très différents sur une scène : il y en a qui ne pensent à rien, l’autre
qui pense à sa musique, à ce qu’il va peut-être faire dans la minute qui
vient ; l’autre aussi a peut-être une appréhension de ce qu’il va faire.
Personnellement, je pense que ces éléments qui sont toujours en contradiction
qui fait que, tout d’un coup, il y a des miracles, sinon tout le monde serait au
point zéro et je ne pense à rien, alors allons-y. J’ai fait des expériences
extraordinaires avec des gens et on ne se disait rien, mais parfois il y avait
20 minutes où il ne se passait jamais rien, où il n’y avait pas de
musique ! Et je vais dire une chose qui était très curieuse : on avait
dit à un type, un ténor italien, de ne penser à rien avant de jouer, mais juste
d’écouter. Il s’est intégré, mais n’était pas du tout dans ce milieu musical. On
a commencé par faire des sons très étranges, un peu genre musique contemporaine,
puis il avait l’air de s’emmerder, évidemment. Puis, il était de plus en plus
énervé etl n’en pouvait plus. Pour lui, ne pas penser à rien, ce n’était pas
possible. Mais nous on jouait pendant vingt minutes et lui, il fallait qu’il ne
pense à rien… Alors, il s’est dit : moi, je ne pense à rien avec tout mon
vécu ?! Alors, tout d’un coup, il a eu une crise terrible. Il y avait une
fenêtre et, pendant qu’on jouait ces sons bizarres, il l’a ouverte et a
gueulé : O! Sole Mio !
L S : Oui, je suis
d’accord avec ce que tu dis, mais, en même temps, quand on se doit d’exprimer
des choses comme ça, par exemple, un paysage de dunes ou la colère, etc., je ne
sais rien du tout de cela, ça sort comme cela. Mais il y a en même temps une
maîtrise et puis quand on est maître de son travail…
M.P., Mais même aujourd’hui, avec l’électronique, ces
sentiments de furie, de sentimalité, de tristesse, de gaieté, d’absence,
d’étonnement existent encore.
L S : Mais
oui.
M.P. : Si vous faites,
‘mmmmm’!, ils vont dire, mais qu’est-ce qu’ils sont tristes, les mecs. Ou encore
qu’ils sont gais dans un autre cas. Mais c’est quand même incroyable. C’est
encore comme les dessins animés, la musique. C’est fou, quoi.
Daniel Humair: Vous n’avez pas d’érection quand vous
jouez ?
M.P. : Ah non !
Pas en ce moment. (Rires dans la salle)
L. S.M. : M. Portal, j’aimerais aborder avec vous
la question de l’enregistrement studio par rapport au live. Je remarque que,
dans les années 70, c’était surtout en spectacle que vous vous donniez, mais
vous faisiez très peu d’enregistrements en studio. Si je regarde votre
production du côté jazz et musiques improvisées, une bonne partie de vos
enregistrements provient de concerts. Pourtant, depuis 10 ans, je remarque que
c’est plutôt le contraire, car vos productions récentes ont davantage été
réalisées en studio. Vous avez toujours exprimé certaines réserves, ou
problèmes, par rapport au studio, puisque c’est un milieu qui vous a toujours
semblé difficile. Vous êtes-vous réconcilié avec le studio
depuis ?
M.P. Le micro me fait peur, voyez-vous. En
musique classique, c’est pareil : j’écoute une prise puis la suivante et je
ne sais pas laquelle choisir. Je ne sais pas si c’est le fait de plaquer quelque
chose, parce que, à dix heures, on va jouer comme ça, mais il faut s’y faire,
quoi. J’aurai préféré prendre la prise que j’ai faite à 14 heures ou… moi, je ne
sais jamais où je vais. Alors, évidemment, Daniel me connaît et je vais amener
un morceau, puis je vais lui dire, on ne joue plus, ou on le jouera peut-être
dans huit jours. Les feuilles, elles tombent comme ça. J’ai cette indécision
permanente. Et quand j’entre en studio, je me pose la question, mais pourquoi
enregistre-t-on à neuf heures du matin ? Mais qu’est-ce qui se passe ?
Le fait de plaquer quelque chose, c’est terrible pour moi. Et c’est pour ça que
j’ai des appréhensions ; quand j’entre dans un studio, je suis malade. Je
me cache, je me mets derrière, je ne mets pas à écouter, je bouche les oreilles,
parce que j’ai peur… je ne peux pas vous dire…Comme il y a des gens qui
n’aiment jouer devant un public, c’est pareil quoi : ils ne veulent plus
aller là. Ils préfèrent jouer chez eux, ou enregistrer chez eux tranquillement.,
moi, je ne suis pas fait pour le disque, je ne suis pas très bon, parce qu’il y
a toute une approche pour le disque : faut écrire, faut savoir, faut
travailler avec les gens. Moi, j’ai toujours fait des disques en catastrophe,
c’est-à-dire au dernier moment, vite, comme ça, et puis c`était fini. Je n’ai
jamais préparé un disque. C’est de ma faute certainement, mais ce n’est pas dans
mon concept de la musique. Le seul plaisir que j’ai, c’est vraiment de jouer en
live, ça, je le dis librement,
devant des gens. Et là, je vais dire, c’était pas bon,
mais je m’en fous vraiment.
L. S.M. : Et le disque, pour toi,
Louis…
L S :. C’est un peu différent pour
moi.Quand j’ai mes groupes, par exemple, ils ont tous des répertoires et sont
fixes dans leur composition. Lorsque j’entreprends un projet, je le joue en
concert pendant un an, parfois deux, mais à force de travailler en scène avec
les musiciens, on arrive à définir une forme qui nous satisfait. On se
dit : tiens, on a trouvé la solution pour ce morceau et, pour un autre, on
a pu trouver la manière de l’exploiter. Donc, au bout d’un an ou un an et demi
de concerts, il y a un moment donné où on se dit : ça y’est, on a à peu
près trouvé une bonne forme, un son, la place de chacun. Donc, on peut fixer ce
moment du programme et, peut-être qu’après, il évoluera encore et sera peut-être
encore mieux. Mais là, je dis, on a la bonne mesure des choses. On peut alors
rentrer en studio, on se prépare, je travaille et, à la limite, je peux voir par
quel morceau on va commencer, qu’est-ce qu’on va laisser de côté, pour y revenir
par après. Je crois que Henri (Texier) travaille aussi de la même manière que
moi,. C'est-à-dire : En faisant un disque avec notre propre groupe, on a
donc un plan et c’est vraiment comme un chantier de travail. On sait qui est le
maître d’œuvre, quel ouvrier va faire la plomberie. On fait vraiment nos disques
d’une façon, je dirais, ‘scolaire’. Par cela, je veux dire qu’on n’attend pas
l’inspiration, on fait ça comme des ouvriers qui préparent un truc. Voilà
donc ma façon de faire un disque. Mais je le fais en sachant qu’il n’y aurait
pas là un éclair de génie parce qu’on l’aura préparé et on essaiera donc de bien
faire ce sur quoi on a travaillé depuis un ou deux ans. Au bout du compte, ça
fait un disque qui est satisfaisant d’une certaine manière, un peu comme une
belle carte postale de ce que représente le groupe et qui va nous permettre de
le vendre. Et c’est important, parce que faire un disque n’est pas uniquement un
travail de création d’œuvre, mais cela répond aussi au besoin de faire connaître
mon orchestre et que les gens se disent que ce n’est pas mal et qu’on le fasse
venir. En général, la sortie d’un disque relance le groupe et lui permet d’avoir
de nouveaux concerts. Pour moi, le disque avec un groupe est surtout cela :
il est un produit qui représente la meilleure image possible de l’orchestre et
je n’attends pas plus que cela du point de vue artistique. Des fois, il se passe
un truc en studio qu’on n’arrivera jamais à refaire, mais c’est très rare.
Voyez-vous, il se peut qu’il y ait des circonstances où je m’emporte
complètement en concert, mais là j’ai un public devant moi qui peut bien y
résister ou qui prenne ce truc-là en y réagissant. Par contre, si je suis devant
un micro en studio et que je fais la même chose, j’ai l’impression d’être un
fou, quoi. Je n’y arrive pas. En public, je peux à la limite jouer un solo de
vingt minutes, mais cela a du sens parce qu’il y a des gens en face qui le
gobent et le digèrent en m’aidant à l’évacuer. En revanche, au bout d’une minute
de solo dans un studio, on dit, oui, cela aurait peut-être été mieux si c’était
un peu plus long, ou encore un peu court, je ne sais pas trop. Mais si je fais
un truc de dingue, j’ai l’impression d’être cinglée, quoi. Il y a personne
devant, juste un micro et c’est vrai ce que dit Michel ici, je n’ai rien à dire
à cet objet-là. C’est compliqué, mais je suis obligé de baliser; je me dis, mon
solo va durer trois minutes et demie et pas plus, parce que cela n’a pas de sens
après ce laps de temps. Enfin, quand je fais un disque comme ‘Napoli’s Walls’
ou n’importe quoi comme ça, c’est comme un orchestre pop. C’est très produit. Je
ne fais pas du jazz, du moins je ne suis pas un musicien de jazz quand je fais
mes disques. Je travaille vraiment comme un musicien de rock, pas du tout comme
un jazzmen. Il y a aussi des disques live, bien sûr,
mais c’est autre chose. On se dit : voilà, c’était comme cela, tant pis ou
tant mieux.
M.P. : Je reviens donc à cette appréhension
d’enregistrer. Lorsque je joue un quintette de Mozart, il ne bouge jamais ce
quintette. La musique de jazz est une chose qui change tout le temps. On ferait
45 prises et on se demanderait par la suite s’il faudrait prendre la 38e ou la
16e. Elles ne sont jamais pareilles. Mais c’est un fait que tous les morceaux
qu’on joue ne se ressemblent jamais à ce que nous jouons en concert. Hier soir,
je suis sûr que notre façon d’avoir joué un des morceaux n’a plus rien à voir
avec celle d’il y a vingt ans. Mais c’est le fait de cette métamorphose du jazz
qui fait que j’ai une appréhension avec le disque, c’est tout. Je dirais :
essayons encore pendant six mois d’enregistrer ce même morceau pour voir ce
qu’il devient. Mais à un moment donné, il faut arrêter, c’est fini, il faut le
prendre. Mais c’est le fait de savoir qu’il pourrait continuer et d’être
totalement différent qui fait que, moi, j’ai des appréhensions. Ou alors on
écrit la musique de A à Z et on dit, voilà, ça s’appelle comme cela et on n’en
parle plus. Comme un quintette de Mozart. C’est tout. Mais il y a toutes ces
musiques aléatoires, celles susceptibles à changements ! Alors, on se
dit : pourquoi attendre demain, on verra bien. C’est tout. Mais on s’en
fout aussi. Comme Louis vient de le dire, le disque est aussi une matière dont
on sert pour se vendre, quitte à revenir sur un terrain qu’on connaît tous par
cœur.
L. S.M. : En juin dernier, Steve Lacy nous
quittait. Vous avez, je crois, tous eu la chance de le côtoyer à un moment ou un
autre. Pour vous aussi, Louis, vous êtes allé même chez lui un jour pour une
leçon. Quelles ont été alors vos impressions respectives à son
sujet ?
M.P. : Il faut dire que j’ai eu beaucoup
d’admiration pour Steve Lacy. Quand il est arrivé en France, quand il a joué
chez nous et fait des enregistrements, j’étais quand même très étonné d’écouter
les phrases qu’il faisaient. Je n’y comprenais rien. Je lui disais, mais
qu’est-ce que c’est que ça? Pourtant, il y avait une intégrité dans toutes ses
compositions, comment il dirigeait sa musique et tout ça. Je crois que j’ai joué
une seule fois avec lui en duo. Il m’a dit, on fait une musique improvisée, ne
parlons pas et ne pensons à rien. Ça c’est passé très, très bien, mais il y
avait toujours ses phrases que je ne comprenais pas, quel est ce langage qu’il
avait appris par le maître qui était là, quoi, à la fois très indestructible et
très originale. Je me souviens que je ne savais pas où aller parfois, il ne
s’agissait pas de lignes, mais le langage était tout de même d’une rigueur
absolue. Mais bon, certainement après, que son parcours a changé, mais je ne le
connais pas très bien. Quand je parle de cet impact qu’il a eu sur moi, c’est
lorsque je l’ai écouté au début. Après, je ne sais pas. Il y a des musiciens
avec qui on peut sortir un petit truc qui fait coucou, coucou, et ils vont le
recevoir, mais avec lui je ne l’aurais pas fait…
D. H. : Steve Lacy est une personne que j’ai
beaucoup vue sans vraiment jouer avec lui pendant près de quinze ans. Avant de
faire ce disque, on n’avait jamais joué ensemble. On se parlait de temps en
temps, pas de musique, mais bien de la peinture qu’il aimait bien. Je l’ai
entendu pour la première fois dans les années soixante à New York avec Buell
Neidlinger et Dennis Charles. Bien que sa musique était intéressante, elle
manquait un peu de vertèbre pour moi. On avait l’impression que ça ne décollait
jamais dans ce que j’aime dans le jazz, soit le côté swing et le côté physique
de cette musique qui, à certains moments, peut devenir assez athlétique. Pour
moi, sa musique me paraissait un peu dévitaminée.
J’avais cru bon de faire quelque chose ensemble avant
qu’il ne reparte pour l’Amérique et c’est moi qui ai décidé de constituer ce
trio avec lui et Anthony Cox. Je voulais offrir une musique de contrastes, mais
sans concession aucune parce qu’il ne pouvait en faire concessions du tout. Cela
s’explique par le fait qu’il était extrêmement limité dans la variété de ses
choix musicaux — et je ne dis pas cela de manière péjorative. Comme la bassiste
a fait autant du free, du tempo que du bebop, donc un spectre beaucoup plus
large, et comme je suis quelqu’un qui fait aussi beaucoup de genres de musiques
qui s’intègrent et s’assimile plus facilement que celles de Steve Lacy, on a
effectivement joué son jeu, mais en apposant nos morceaux et notre esthétique
physique. Il est vrai que son univers se situait un peu en parallèle au jazz
rythmique. Il a même dit un jour : ´ Quand on joue un morceau, par
exemple un thème comme ´ All of Me ª, les improvisations se font sur
la mélodie et non les accords. ª Quand il jouait un blues, comme
´ Straight No Chaser ª, toutes ses improvisations étaient des
variations sur ce thème-là, alors que les autres jazzmen jouent des chorus qui
n’ont rien à voir avec la mélodie, mais bien l’harmonie. Vu ainsi, le thème
n’est qu’un prétexte qui n’a rien à voir avec l’improvisation. Lacy, par contre,
allait vraiment au bout de l’improvisation sur un genre de morçeau.
L’expérienmce de jouer avec lui était intéressante, parce qu’on lui a fait faire
des choses qu’il n’avait jamais fait auparavant, comme la technique du
re-recording, qu’il ne connaissait pas du tout. (En dépit de cette assertion,
Steve Lacy connaissait ces techniques d’enregistrement et les a utilisés par le
passé, remontant à 1971 avec l’album ´ Lapis ª sur Saravah et
d’autres par la suite, n d. l r) On a essayé de faire un morceau avec deux voix
et où on passait de l’une à l’autre. On lui disait, ne t’occupes pas de nous, on
va passer d’une voix à l’autre. J’avais l’impression de travailler avec un
amateur à ce niveau-là. Mais il n’en demeure pas moins que le résultat est très
intéressant parce qu’il arrive avec une espèce de touche comme il était dans la
vie de tous les jours, un genre de personnage glabre et triste. Il était gris et
sa musique l’était aussi. J’ai trouvé cela intéressant de le mettre dans un
contexte avec quelqu’un qui bombarde et un batteur qui a envie de rigoler. Quand
je fais de la musique, c’est pour rigoler et c’est un plaisir, la batterie, ça
reste un jeu. Le résultat est bon parce que c’était un jeu de contrastes. En
somme, c’était quelqu’un de très marginal qui ne pouvait pas se mélanger avec le
jazz en général, qui tend souvent à l’exhibition.
Lacy avait donc son univers et il y a quelques cas de ces
univers fermés. Un que je connais vraiment très bien c’est Martial Solal. Il est
bon dans sa musique, mais celle des autres ne l’intéresse pas. Pour lui, un bon
musicien c’est quelqu’un qui comprend ce qu’il fait, qui le suit. Mais lui ne se
servira pas de vous pour faire monter sa musique. Quand Lacy allait donner un
cours au conservatoire, c’était un cours sur comment comprendre la musique par
la sienne. Ce n’était pas de la prétention de sa part, mais il vivait dans un
petit univers fermé à Paris, sans jamais vraiment comprendre ce qu’il y avait de
bon en France. Quand il est parti, il a fait une réflexion épouvantable qui a
paru dans le journal et c’était : ´ Je m’en vais parce que les
Français ne s’intéressent qu’au football. ª À cela, je répondrais que les
Américains qui restent entre eux et qui ne veulent pas voir le pays, ils n’ont
pas à être là. Donc, dans sa musique, il avait son petit monde où on pouvait
aller chez lui, mais pas le contraire. Et je me demande même s’il avait la
capacité d’aller chez les autres.
L.S.:Quant à moi, Lacy
c’était quelqu’un d’intéressant comme tous les gens qui le sont, car il a
quelque chose d’atypique et sur lequel il a insisté. Mais il est vrai que
c’était difficile de jouer avec lui par exemple, quand on joue aussi du soprano,
c’était difficile, ce qui n’est pas le cas de Michel Portal, parce qu’on arrive
vite à accorder nos sons après avoir joué quelques notes ensemble, et à trouver
un mouvement commun par après. Mais avec Steve Lacy, pour arriver à trouver dans
sa phrase un endroit où on allait pouvoir connecter avec lui, c’était
extrêmement difficile, parce qu’il était dans une espèce d’abstraction très
anglo-saxonne. Je trouve qu’il y a quand même une grande différence dans notre
façon de souffler, qui est latine, et sa façon à lui de souffler. Là, on a
vraiment une histoire de deux civilisations. Par contre, on n’a pas cela avec
Joe Lovano. Michel et moi avons eu l’occasion de jouer avec lui et ça se passe
tout seul, on arrive très vite à mélanger nos sons, mais avec Lacy c’était
presque impossible. Cela peut aussi être le cas avec Evan Parker. Il ne faut
donc pas chercher à jouer ensemble, mais à se mettre en parallèle sans vraiment
vouloir chercher à communiquer directement. Voilà, tu es comme cela, je suis
comme cela, alors restons sur nos rails, puis peut-être que le mélange va se
passer à un moment donné. Mais c’était un rapport comme cela. Et il en était de
même sur le plan humain, puisqu’on avait des rapports du même type avec lui,
soit en parallèle et où on essayait de les confronter ainsi plutôt que d’avoir
des convergences, ce qu’il ne recherchait pas non plus et qui ne le satisfaisait
pas normalement.
Je l’ai aussi connu lorsque je suis allé le voir chez lui
en lui disant, il y a de cela une vingtaine d’années ou plus, que je voulais
apprendre un thème de Monk, c’est tout. Donc, il a passé la matinée avec moi
bien gentiment, puis il a pris un thème et m’a dit ce que Daniel vient de
dire : chez Monk, il n’y a pas d’harmonie, juste deux notes. Monk lui avait
d’ailleurs expliqué qu’il avait mis deux notes là sur le thème et c’est tout,
mais lorsque Lacy lui demandait ce qu’était l’harmonie et Monk lui répondit tout
simplement que c’était juste deux notes. C’était ça l’idée de Lacy. Mais c’était
en même temps quelqu’un qui avait une chaleur humaine, bien qu’il la
transmettait d’une manière différente de la nôtre.
L S.M. Y-a-t-il des gens dans la salle qui désire poser
des questions à nos invités ou qui veulent tout simplement ajouter leurs
commentaires ?
Intervenant : : J’aimerais commenter sur ce
que Michel et Daniel ont dit sur cette notion de se comprendre et de se
connaître dans une société qui s’aide. Il me semble que la société américaine
est bâtie sur l’entrepreneurship, l’individualisme Chez eux, on va sentir qu’il
y a un leader en avant qui, lui, a des idées, puis tout le monde suit. Je crois
que cela est une façon plus anglo-saxonne de comprendre le jazz, alors qu’en
Europe c’est beaucoup plus l’esprit social, ou communautaire. Il y a des
regroupements sociaux et politiques qui témoingent de cela et le style de jazz
qu’on écoute en est le résultat.
M.P. Il est difficile de parler comme cela parce et
même si on peut s’y opposer ou non à la façon que les gens de notre culture
jouent, il ne faut pas oublier que, eux, ils ont quand même leur culture, qui
est celle du jazz. Je pense que les jeunes Américains qui vont à Berklee
défendent leur musique, qui, après tout, est le jazz. Moi, je ne vais pas dans
ce domaine-là en disant que l’Europe c’est qu’ils font ça, ils ont la musique
qui va dans tous les sens, comme ceux qui sont complètement dans le milieu
classique. Moi, je ne touche pas ce terrain, parce que je suis très respectueux
des gens qui ont inventé le jazz. Et c’est eux qui l’ont vraiment créé au
maximum.
D H : [Intervention hors micro, transcription
approximative]
Ça ne marche pas pour la simple et bonne raison que le
jazz est né aux États-Unis d’une fusion de musiques et d’instruments européens
avec une sensibilité de groove africain. Des gens de notre génération, comme
Henri Texier ici qui a 60 ans et moi qui en a 66 – et j’ai commencé à faire du
jazz à 15 ans – à comparer à un musicien qui joue du jazz maintenant sur la
scène, ils s’étaient fait parler […] Bud Powell, Cannonball Adderley, alors de
parler de l’histoire de la musique américaine et celui du jazz des Européens, ça
ne marche plus. […]
M.P. : Daniel, ce n’est pas cela que je voulais
dire.
D H. : Passons à un deuxième problème, dont il est
aussi très important de souligner, et après cela je me tairai parce que je n’ai
rien à dire ici. La grande différence entre l’Europe et l’Amérique, c’est que,
malheureusement pour eux – et ce n’est absolument pas de leur faute –, le jazz
une musique d’entertainment. Dans la plupart des lieux – et il y a des
exceptions bien sûr, tant à New York que dans la plupart des autres villes
américaines –, le jazz est joué pour les gens qui mangent. Il y a des musiciens,
et même parmi les plus grands aussi, que j’ai vu, comme Oscar Pettiford ou Dizzy
Gillespie qui jouait alors que personne ne les respectait ; on ne leur
accordait même pas un moment de silence. En Europe, s’il y a un bruit de
fourchette ou une personne qui parle trop fort, on s’arrête et on dit :
c’est vous ou nous. En Europe, c’est devenu une forme de musique de concert. Et
c’est ce qui permet à des gens comme Sclavis, Portal, Texier et bien d’autres
que vous connaissez et qui ne sont pas présent, de faire la musique qu’ils
veulent parce qu’ils sont maîtres de leur musique. Ils n’ont pas un producteur
qui leur dit de faire ceci ou cela… Ils ont donc une liberté absolument
indispensable à une musique de jazz qui s’écoute, au lieu d’en être une de fond
tout simplement. L’histoire du jazz américain et l’histoire du jazz français, ça
veut strictement rien dire. Vous le savez, la plupart des grands bassistes,
comme aux États-Unis, ce sont des Européens : Dave Holland vient de
Londres, Miroslav Vitous vient de Tchécoslovaquie, un pays qui n’en n’était pas
un de jazz non plus. (. Bien qu’ayant vécu aux États-Unis, Vitous vit maintenant
en Allemagne depuis de nombreuses années n.d.l.r..). En Italie, il y a des
musiciens formidables. Il n’y a plus de différences, c’est ça, mais la question
du business est une américaine.
M.P. Henri, voudrais-tu dire quelque chose de ce que tu
penses de tout cela ?
Henri Texier : À mon avis, il y a autant
d’approches de cette musique que de musiciens, et c’est ce que vous venez de
dire en gros. Quant au rapport avec les États-Unis, il vrai, bien sûr, que cette
musique est née aux États-Unis, en particulier dans le sud. On ne va pas tout de
même refaire l’histoire de cette musique ici, mais elle conditionne ce que nous
jouons en ce moment aujourd’hui, qu’on soit Américain ou Européen. En ce qui
concerne Paris et la France, c’est vrai qu’on a des musiciens de jazz
afro-américains et c’est ceux-là qui ont été le plus en vue, et ceux-ci se sont
installés chez nous à compter des années 20. Tout de suite, il y a eu des
rapports avec les musiciens qui vivaient à Paris ; tout de suite, il y a eu
des rencontres, et cette musique-là a eu une façon d’exister, du moins à Paris,
car je ne saurais parler pour toute l’Europe. Il y a eu des connexions en Europe
du Nord aussi, à Londres, et ainsi de suite. Comme Daniel vient de le dire, il
est vrai que cette musique s’est installée pour faire un peu plus class et il
est aussi vrai que cette musique est née un peu de la rencontre entre la
tradition écrite européenne et de la tradition orale africaine. Ainsi, elle
devint assez rapidement une musique planétaire. Je voudrais aussi souligner un
autre petit détail, mais que je trouve très important par rapport à la diffusion
planétaire de cette musique, et c’est l’évolution des techniques
d’enregistrement. C’est grâce à cela aussi que cette musique-là a envahi la
planète, mais on n’y pense pas tellement. Voyez-vous, les gens de notre
génération ont appris en essayant de reproduire ce qu’on entendait sur les
disques qui venaient des États-Unis, si bien qu’on avait essayé de les imiter
pendant des années. Il était très facile de jouer cette musique-là parce qu’on
achetait le dernier Coltrane et on essayait exactement de faire la même chose et
on était vachement content. Et il en était de même lorsqu’on se mit à voir et à
travailler avec les musiciens américains de passage à Paris, on se mettait
vraiment à comprendre et à vraiment bien sentir leur musique. Ils nous disaient
même qu’on devrait aller à New York, parce qu’on trouverait du boulot
immédiatement, etc. Mais on a eu des chances chez nous qui nous ont fait penser
que ce n’était pas peut-être pas plus malin de continuer notre truc chez nous,
quoi. On s’est vite rendu compte très vite que si on voulait, comment dirais-je,
jouer cette musique-là aux États-Unis, il n’était pas question pour nous de
donner des concerts là-bas comme eux pouvaient le faire en Europe. Si tu veux
jouer aux États-Unis, il faut devenir Américain, quoi,il faut s’y installer
d’une certaine manière et entrer dans le moule, quoi . Et je ne parle pas
juste du moule social, mais artistique aussi. Cependant, aux États-Unis, il n’y
a pas que des mecs qui sont dans le show-business, il y aussi des gars qui
cherchent et qui sont marginaux, qui se démerdent ou qui se débrouillent en
essayant de vendre leurs disques à la sortie de concert pour essayer de
survivre, donc d’avoir une certaine indépendance et liberté vis-à-vis du
système. Je crois que c’est la situation qu’on a vécu. Au début des années 80,
par exemple, Daniel a été un des tous premiers en France à inviter des grands
solistes américains, donc à construire des groupes où il invitait des grands
musiciens américains à venir le rejoindre pour de projets de tournées et
d’enregistrement. Ça m’est arrivé un petit peu par la suite, dans les années 80,
d’inviter Joe Lovano ou Steve Swallow, des gens comme cela, très régulièrement,
d’avoir des liens avec eux, une vraie relation, quoi . Et cela se poursuit
toujours d’ailleurs. Quand je leur racontais que j’avais joué avec Kenny Clarke,
Bud Powell, tous ces gens-là, ils étaient sur le cul, quoi, ils étaient super
admiratifs parce que même un musicien américain qui est venu à la même époque
que nous et vivant à New York n’aurait jamais eu la chance de rencontrer et de
côtoyer ces gens-là. J’ai appris cette musique-là avec ces musiciens-là. Pour
terminer mon intervention, je pense que ce qui caractérise cette musique-là,
c’est qu’elle est une musique initiatique ; elle en est une qui se transmet
presque de manière je dirais épidermique, ce qui, pour moi, est la grande partie
qui vient de l’Afrique. Chacun voudra savoir avec qui il avait joué, parce qu’on
saura que les choses ne sont pas du tout les mêmes et qu’elles se transmettent
de cette façon-là. L’enregistrement nous a donc permis de connaître cette
musique-là et à véhiculer la tradition orale des maîtres.
D. H.: […] Prenons des musiciens qui ont 25 ans
maintenant et qui font du néo be-bop. Que font-ils ? Ils écoutent des
disques des maîtres, Miles Davis, Freddie Hubbard, Coltrane, et ils essayent de
faire la même chose. C’est la seule façon, c’est une musique qui s’apprend comme
ça, ce n’est pas ce qui est vraiment écrit. Il y a des écoles de jazz partout
maintenant.
Intervenant : Je voulais juste offrir un
commentaire qui m’est arrivé spontanément par rapport à l’idée du jazz américain
et ces trucs-là, mais le jazz est né bien malgré les Américains. Si on y
réfléchit bien, c’était vu comme une musique de sauvages.
H.T. : C’est-à-dire, si on veut vraiment entrer
dans les détails, et j’essaierai d’être bref par rapport à la véritable
historicité de cette musique-là, le jazz, c’est le résultat parfait de
l’impérialisme des blancs sur les esclaves noirs. C’est exactement cela.
C’est-à-dire, quand les premiers esclaves noirs sont arrivés aux États-Unis, sur
le continent américain, on sait très bien que leur expression essentielle était
la musique. Pas seulement pour faire le tam-tam, mais les gens vivaient et
vibraient par cela, car c’était leur seul moyen de s’exprimer vraiment. Et quand
on voyage en Afrique, on se rend compte que c’est extrêmement important. Donc,
on leur a immédiatement interdit, parce que c’était une manière de les tenir
sous leur joug. Et ensuite, les maîtres blancs se sont rendu compte que
c’étaient des gens qui avaient un talent musical et qui en avaient de besoin et
ils leur ont donc demandé, ou même obligés de jouer des musiques européennes. Et
c’est comme ça que le jazz est né : dans les plantations et par
l’esclavage.
M.P. : Excusez-moi, mais avant de parler de ses
histoires sociales ou pas, citez-moi une musique dans le monde où
l’improvisation codée ou non codée existe ? Dites-moi : jouez avec un
musicien de flamenco demain, avec un iranien, un algérien, un mec de Tombouctou,
vous allez voir : tout d’un coup, ce qui se passe, c’est qu’il va vous
regarder et vous dira : Mais pourquoi vous faites ça ?
Pourquoi ?
D H. : Une incompréhension
totale.
M.P. : Non, c’est pas ça. Dans le jazz, on peut
étaler son savoir et personne n’en aura à redire. On pourra peut-être dire, mais
il n’a pas très bien joué dans le chorus ou pas, qui soit codé ou non. Le
miracle du jazz, pour moi, c’est ça. Si vous faites de la musique contemporaine
et que vous improvisez, on vous dira : mais qu'est-ce que tu fais là? C’est
pas ça, faut pas faire ça. Expliquez-moi où sont les autres musiques où l’on
s’amuse sur une scène avec cette sorte d’improvisation qui est née là, dans
cette musique-là. Mais jouer même avec un Africain, il va vous dire que ton truc
ne se fait pas comme ça. Il n’y a aucune musique aujourd'hui, aucune, où c’est
possible de s’amuser comme cela. Aucune. Sauf des félés qui… peut-être. C’est
tout pour moi. Tu es d’accord, Henri ?
D H : [portion inaudible] qu’il y a quand même
beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis qui peuvent être très sincères. S’il
y a eu Miles Davis, ´ Kind of Blue ª et des choses comme cela, c’était
pas parce qu’il voulait gagner de l’argent avec cela, mais c’est un cas très
particulier. Alors, ça s’est transformé. On généralise un peu, mais il y a
certainement aux États-Unis, et un peu partout dans le monde aussi, des gens qui
font une musique parce qu’ils y croient vraiment. Ils ne font pas cela comme
pour jouer une petite bossa avec une chanteuse et d’avoir derrière eux toute une
industrie qui les pousse. Vous savez que dans les festivals de jazz en Europe,
c’est quasiment impossible de les faire s’il n’y a pas une chanteuse. On en
revient au même point. J’ai vu cela à la télé hier soir, une émission sur les
orchestres de Paul Whiteman, Artie Shaw où, tout d’un coup, il y a une chanteuse
ou un chanteur, et c’était tout à fait bien vu d’avoir un chanteur soliste et
c’était devenu une obligation. Et on est en train de retourner là-dedans ;
on est en train de remettre l’étiquette jazz à tout ce qui chante et qui a un
petit rythme derrière et on fait un produit d’ersatz qui se vend et qui bouffe
les vraies productions d’artiste du monde entier qui fait de la musique de
concert. Je crois que tous les gens qui s’intéressent au jazz devraient essayer
de pousser pour redonner une qualité musicale à une musique d’écoute et pas une
d’ambiance.
Intervenant : Comment se comporte le jazz de
création en Europe en ce moment ? Est-ce difficile pour vous
encore…
L S : Il faut quand même se rendre compte que, en
Europe, et notamment en France, c’est un des pays où il y a quand même pas mal
de choses qui se passent, mais ça peut toujours être mieux. Il se passe beaucoup
de choses parce qu’il y a beaucoup de musiciens de partout en France, et ce
n’est pas uniquement localisé à Paris. Il y a aussi un peu de moyens pour
travailler et il est évident que cela a été beaucoup une question de moyens,
c'est-à-dire qu’il y a eu une politique culturelle qui est arrivée il y a de
cela un peu plus de 20 ans et qui a décidé de mettre de l’argent dans toutes ses
musiques, soit en construisant des salles, ou d’avoir un circuit culturel
structuré. Ça, c’est de la politique, en l’occurrence que veut-on faire des
fonds publics ? Quand la gauche est arrivée avcc Jack Lang, et même si
c’est très peu par rapport au reste, cela a quand même eu le mérite d’exister.
Ils ont dit : ´ Voilà, on va aider ces musiques-là, comme pour le rock
et le folk. ª On va donc donner des subventions, on va permettre à des gens
d’y travailler dans ce créneau, et ainsi de suite. Donc, pendant 20 ans, cela a
donné un cadre quand même pas mal, avec des festivals importants et de l’argent
pour des créations. Il est vrai qu’il y a beaucoup d’essais en France
musicalement, avec des gens qui essaient des choses et des mélanges aussi, qui
proposent donc des formes de musiques audacieuses. Il y en a encore de cela.
Pourtant, il y a des restrictions dans toute l’Europe, comme en Allemagne – et
l’Angleterre on n’en parle pas parce que Thatcher a fait un mal fou. Mais en
France aujourd’hui, ça recommence, en Italie, ce n’est pas gagné. Après ces 20 à
25 ans, on resserre les boulons, il y a beaucoup moins d’argent pour la culture
et, forcément, ça devient difficile, parce qu’il y a beaucoup de jeunes
musiciens qui ont du mal à exister et à y vivre. Donc, avec un certain modèle
américain politique, on est en train de revenir en arrière et ça, ça devient
dangereux parce que je ne vois pas trop comment on va renverser la vapeur dans
les dix prochaines années. Donc, il y a toute une création qui existe en Europe,
et notamment en France, qui est en danger parce que ce n’est pas sûr que, dans
les années à venir, ça continue à exister. Il y a beaucoup de festivals, et
certains se sont arrêtés ou ont bien des difficultés. Mais il est vrai que, par
rapport à beaucoup d’endroits, on a été quand même assez privilégié, mais on
s’est quand même battu pour, ce n’est pas tombé du ciel. On a voté et il y a eu
de la politique autour de tout cela. Mais notre combat en ce moment, c’est de
préserver cet acquis, qui ne l’est jamais vraiment en fait, et qui se trouve
très menacé aujourd’hui par les politiques européennes. Il faut voir cela comme
ça, parce que les politiques européennes se construisent et que l’Europe est en
train de devenir quelque chose de très compliqué. Mais au lieu de tirer les
choses vers le haut, c’est le plus petit dénominateur commun multiple qui le
remporte et donc, on tire vers le bas. Donc, ce que nous avons gagné en France,
on aimerait que ce soit l’Europe qui en profite et, en revanche, tout est menacé
par des pays pour qui ça n’intéresse pas et qui, au contraire, sont en train de
tirer tous ces acquis culturels, sociaux et autres par le bas au lieu d’être
pour le terrain. En fait, c’est ce qui est le meilleur dans chaque pays qui
remporte pour faire profiter les autres, mais ce n’est pas le cas. Le cas de
culture en Europe, c’est loin d’être gagné et, pour les quelques années qui
viennent, je suis plutôt pessimiste sur ce qui va se passer, parce qu’il y a une
libéralisation à outrance des services culturels. La notion des services publics
disparaît, donc la culture va être la première à y passer. En France, par
exemple, on est en train de changer le fonctionnement des établissements publics
pour qu’ils soient aussi subventionnés par le privé. Donc, aujourd`hui, vous
avez une scène nationale qui est normalement un outil public et là, on change
les statuts pour que, un jour, il se pourrait que ce soit Coca Cola à qui on
devrait s’adresser pour louer la salle, parce que c’est eux qui feront la
programmation. Ça y’est, c’est parti maintenant, le système est
enclenché. La culture en Europe est un peu en danger. Pour l’instant, ça
va, il se passe beaucoup de choses au niveau de la création, mais sans lieux
pour jouer, sans argent…
D H. : Mais pour les gens qui sont un peu connus,
les concerts sont quand même pleins, et dans les petites villes aussi. C’est un
phénomène quand même assez intéressant.
L S. : Oui, c’est vrai, il y a quand même un
optimisme, parce qu’il y a beaucoup de public et beaucoup de gens en veulent
aussi. Mais seulement si les gens, un jour, en veulent, mais on leur dit qu’il
n’y en a pas… ça, c’est vraiment dégueulasse. Parce que je trouve qu’il y a un
public fou, et il y a de plus en plus de gens qui se déplacent pour le théâtre
et pour la musique. Il y a vraiment une envie des gens d’aller voir des choses
différentes, ou alternatives, par curiosité. Mais en ce moment, on est en train
de leur dire : nous on a décidé que ça, c’est de la connerie et que vous ne
l’aurez plus. C’est une situation très conflictuelle, mais qui est loin d’être
gagnée.